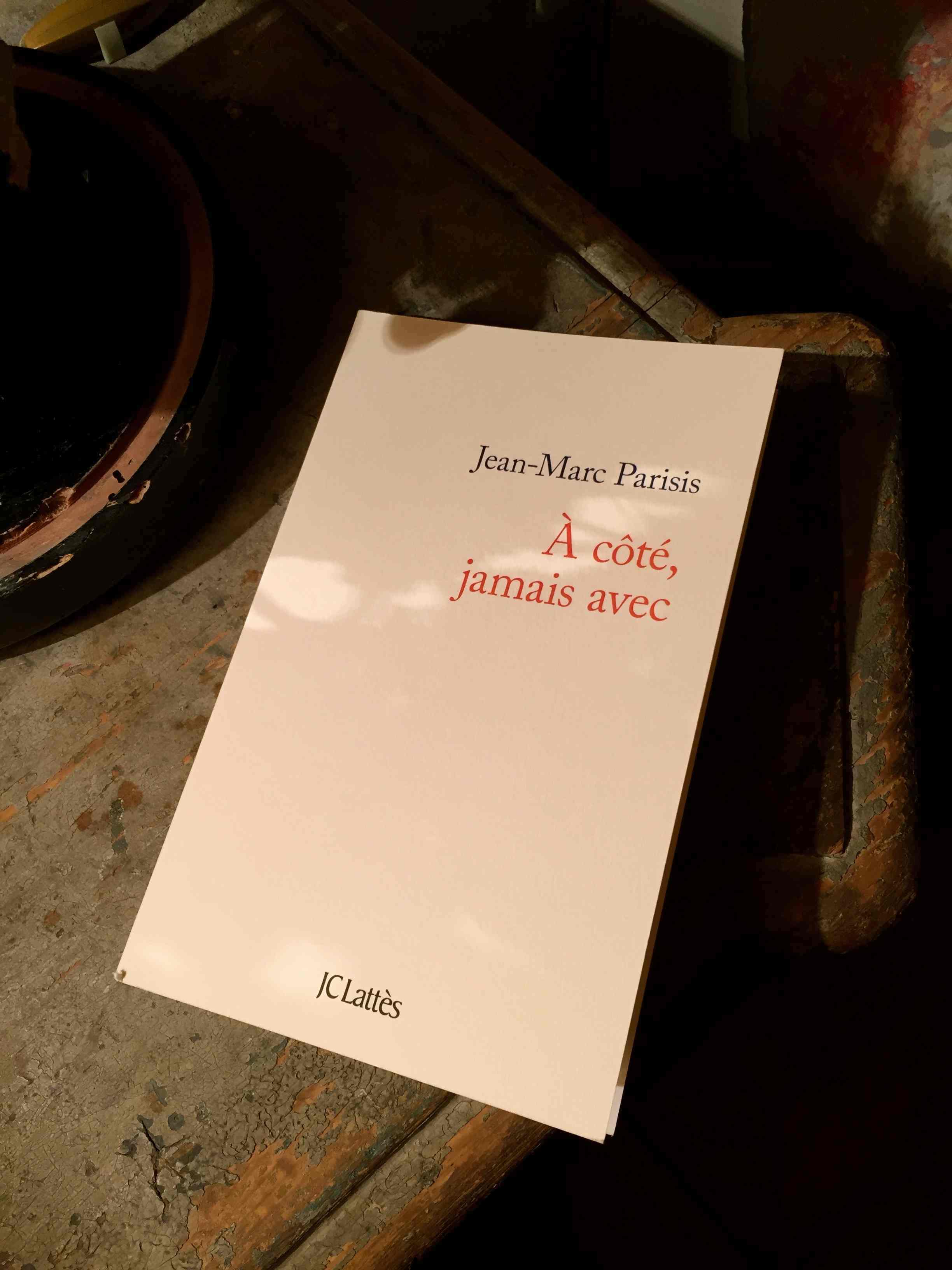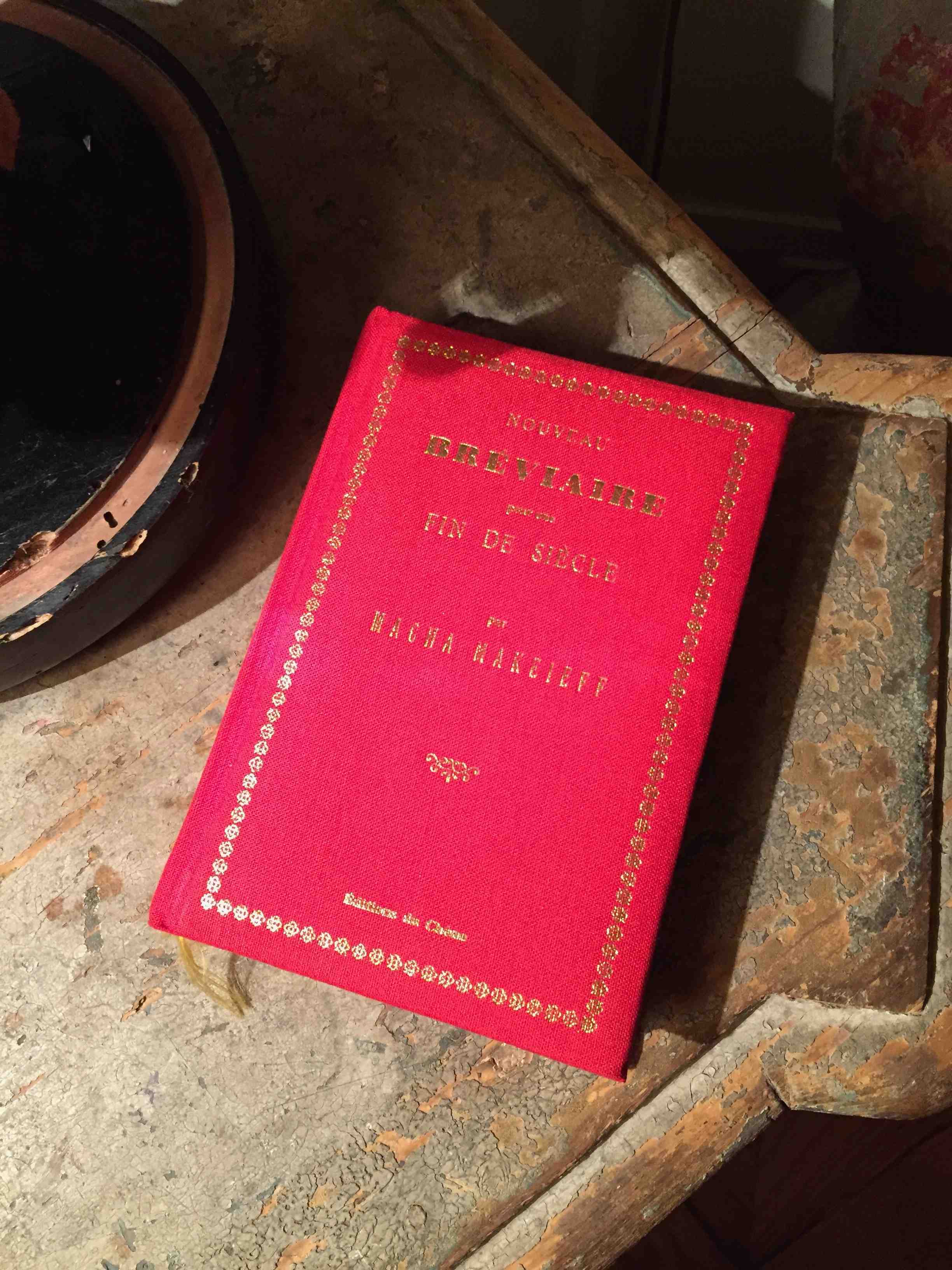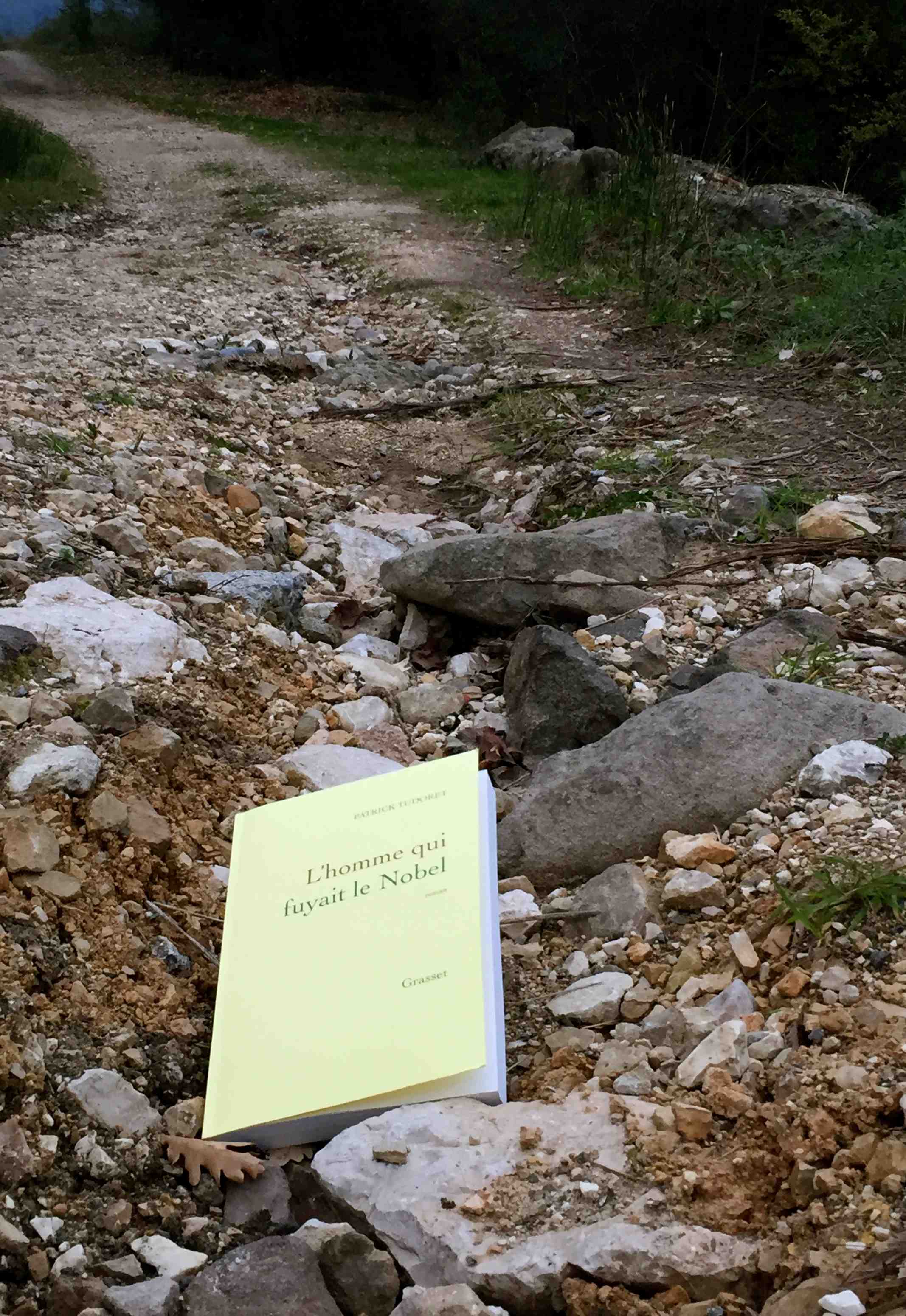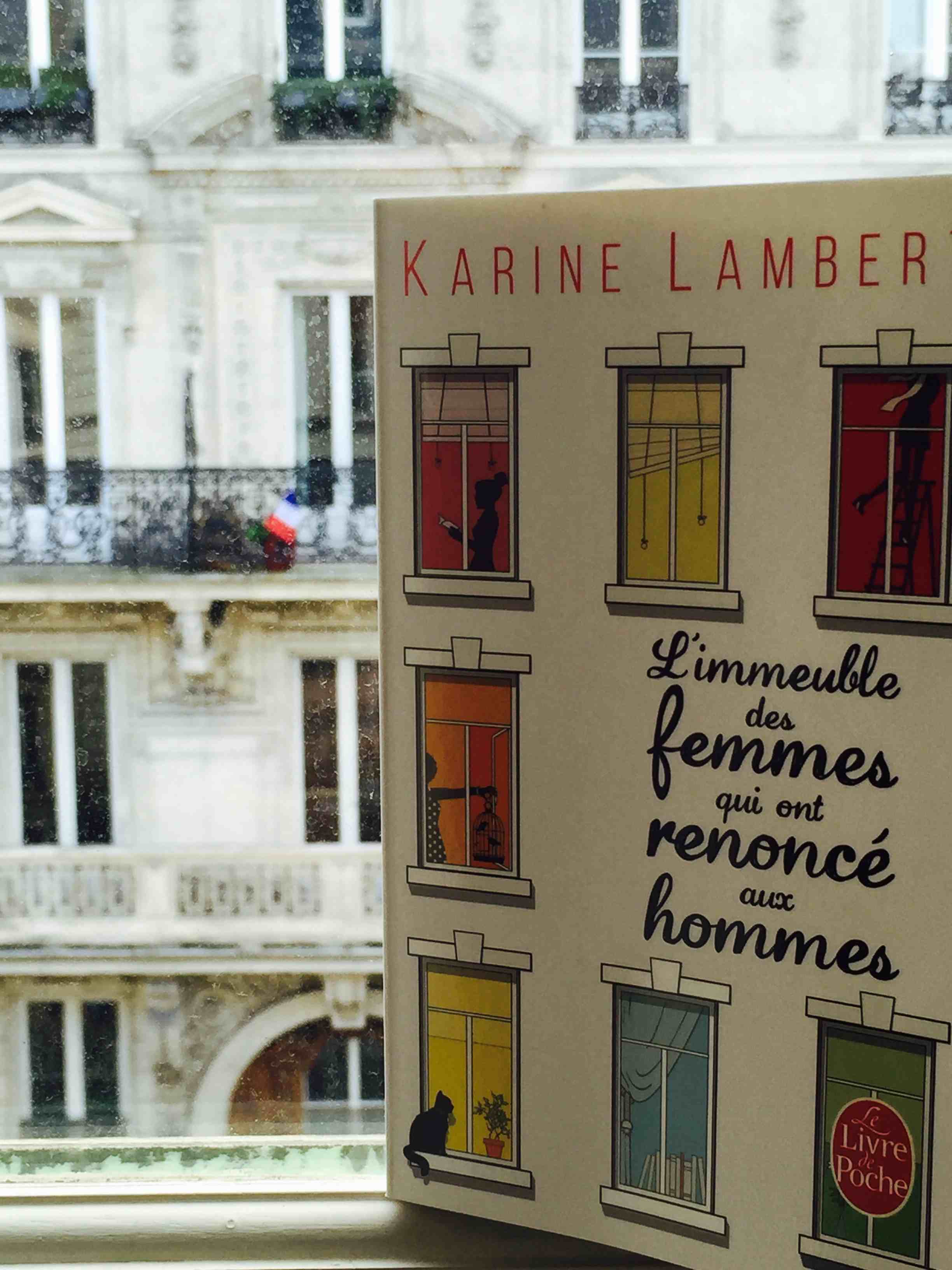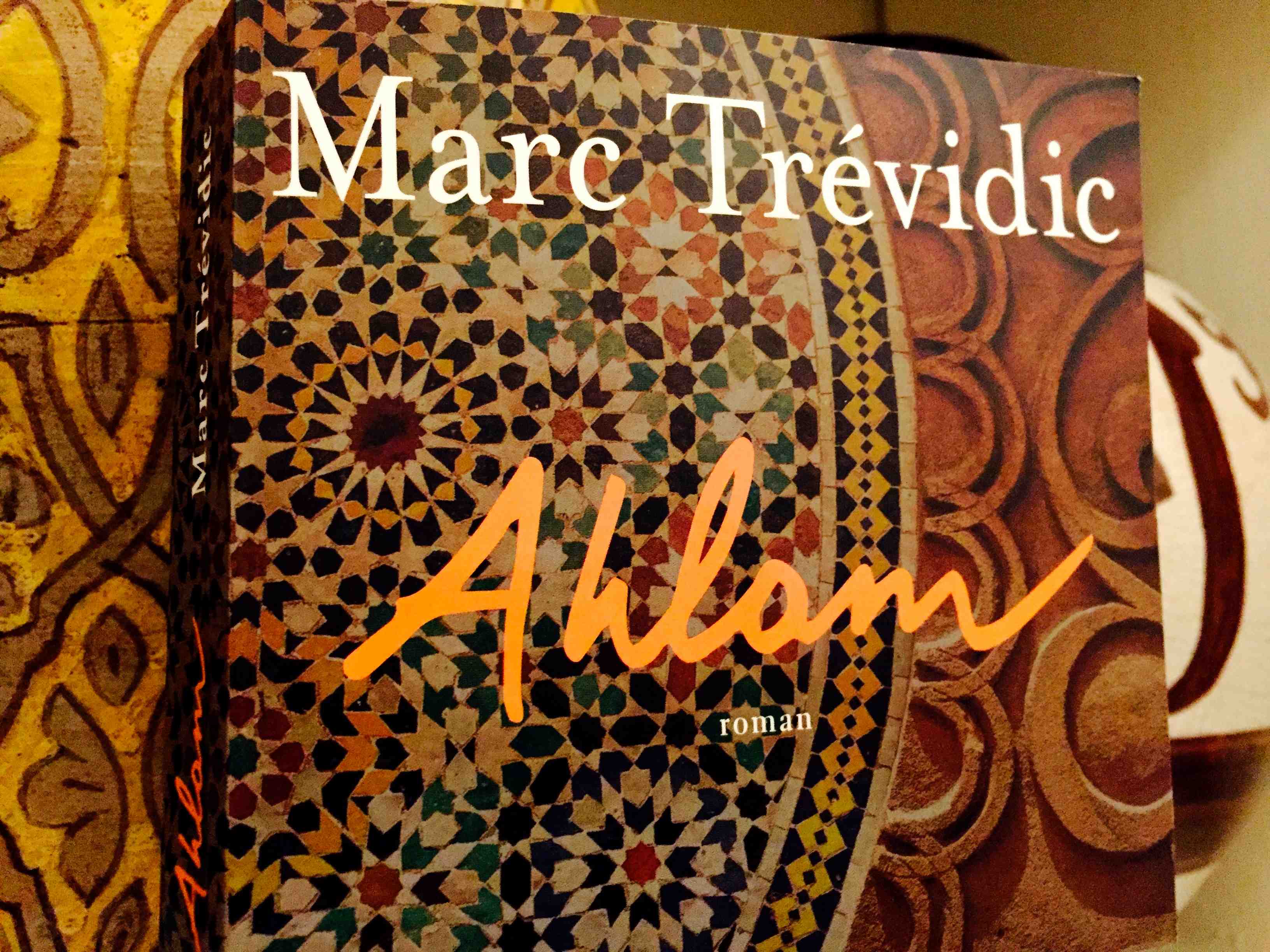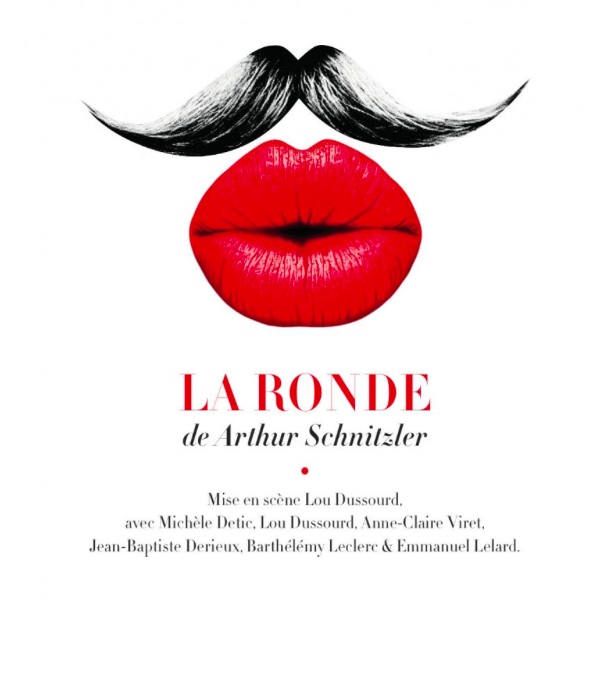Bien qu’il s’agisse de souvenirs d’enfance que Jean-Marc Parisis écrit ne pas regretter, écrit s’en souvenir, la rêver, l’imaginer encore, « À côté, jamais avec » est, d’une certaine manière, une sorte de dictionnaire de l’enfance, comme il y a des dictionnaires du piano, de la nostalgie et des pin-up des années 60.
Nous voilà, dès les premières pages, entraînés dans le sillage du jeune Jean-Marc, près de son école blanche à Versailles, à bord du car Chausson et ses sièges en skaï vert ou marron, ou encore dans la DS ou la R 16 du père, dans les rayons de la superette Super Jalon et surtout dans ces mots de l’enfance de ces années là, ces mots, auxquels sa plume d’une délicatesse inouïe, redonne vie, images et parfum. Ainsi le guidon bracelet de la Malagutti et autres bécanes, autres meules. Le mono de la colo. Les fascicules Alpha. Le coup du hérisson dans les cours de récré. Les avions en balsa. Les gamins qui chourent. Les soutifs des filles à la piscine. Parisis réveille une langue morte, précise et magnifique : celle de nos enfances (nous avons pratiquement le même âge), ce langage que l’on perd en grandissant, pour sombrer, écrit-il, dans « la langue artificieuse, bêtifiante, concupiscente, une langue d’adulte fantasmant sur la langue des enfants – ni plus ni moins qu’une entreprise de corruption, tout à fait officielle » (page 129). Et comme les livres (pour enfants) sont encore plus beaux avec des images, je ne saurais trop vous recommander de suivre la balade de Parisis en glissant ce petit bréviaire** dans la poche de votre K-way, ou en l’attachant avec un sandow sur le porte bagage de votre biclou.
*À côté, jamais avec, de Jean-Marc Parisis. Éditions Lattès. En librairie depuis le 20 janvier 2016.
**Nouveau Bréviaire pour une fin de siècle, de Macha Makeïeff. Éditions du Chêne. En librairie depuis le siècle dernier, le 18 novembre 1998 exactement.