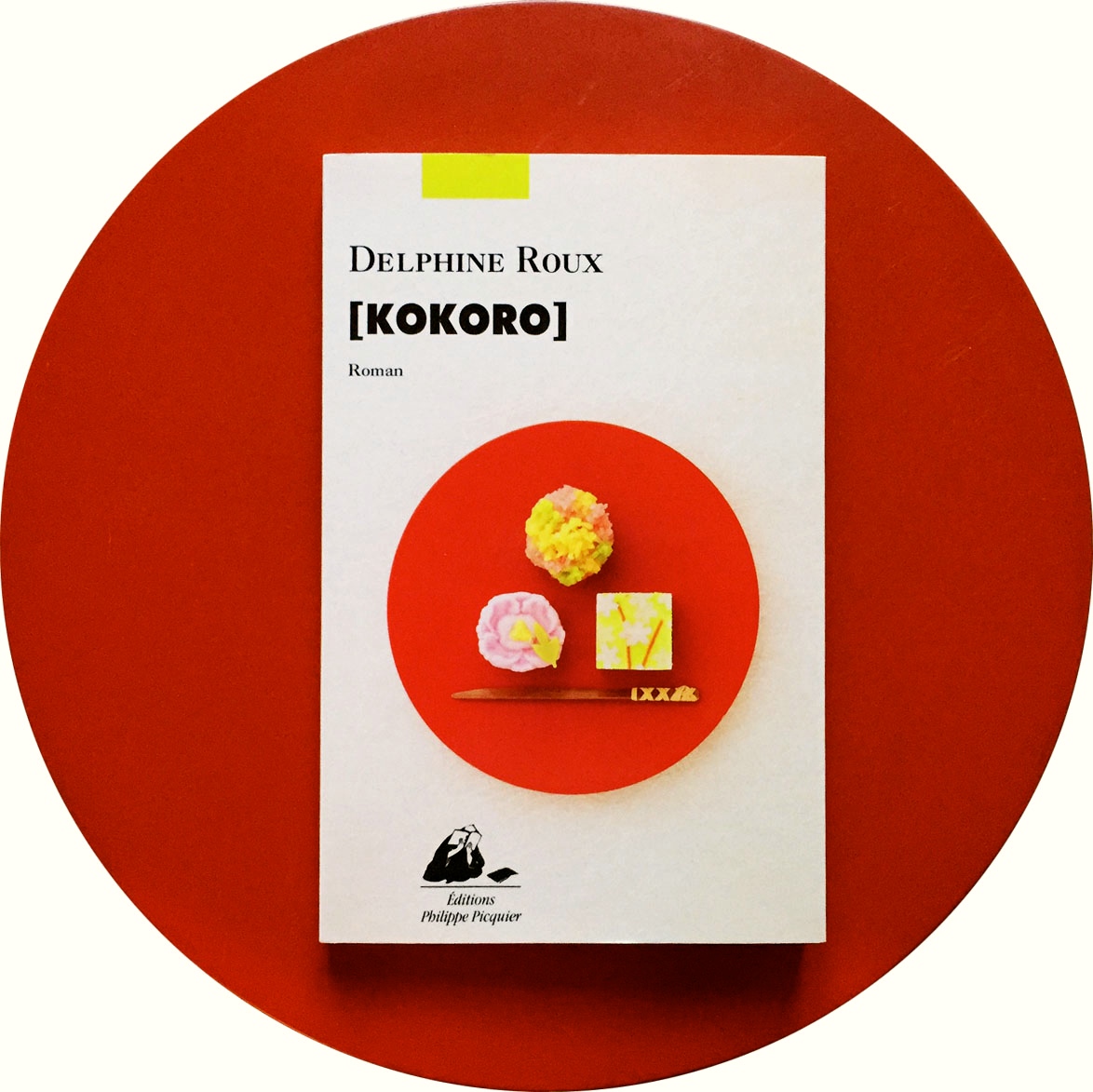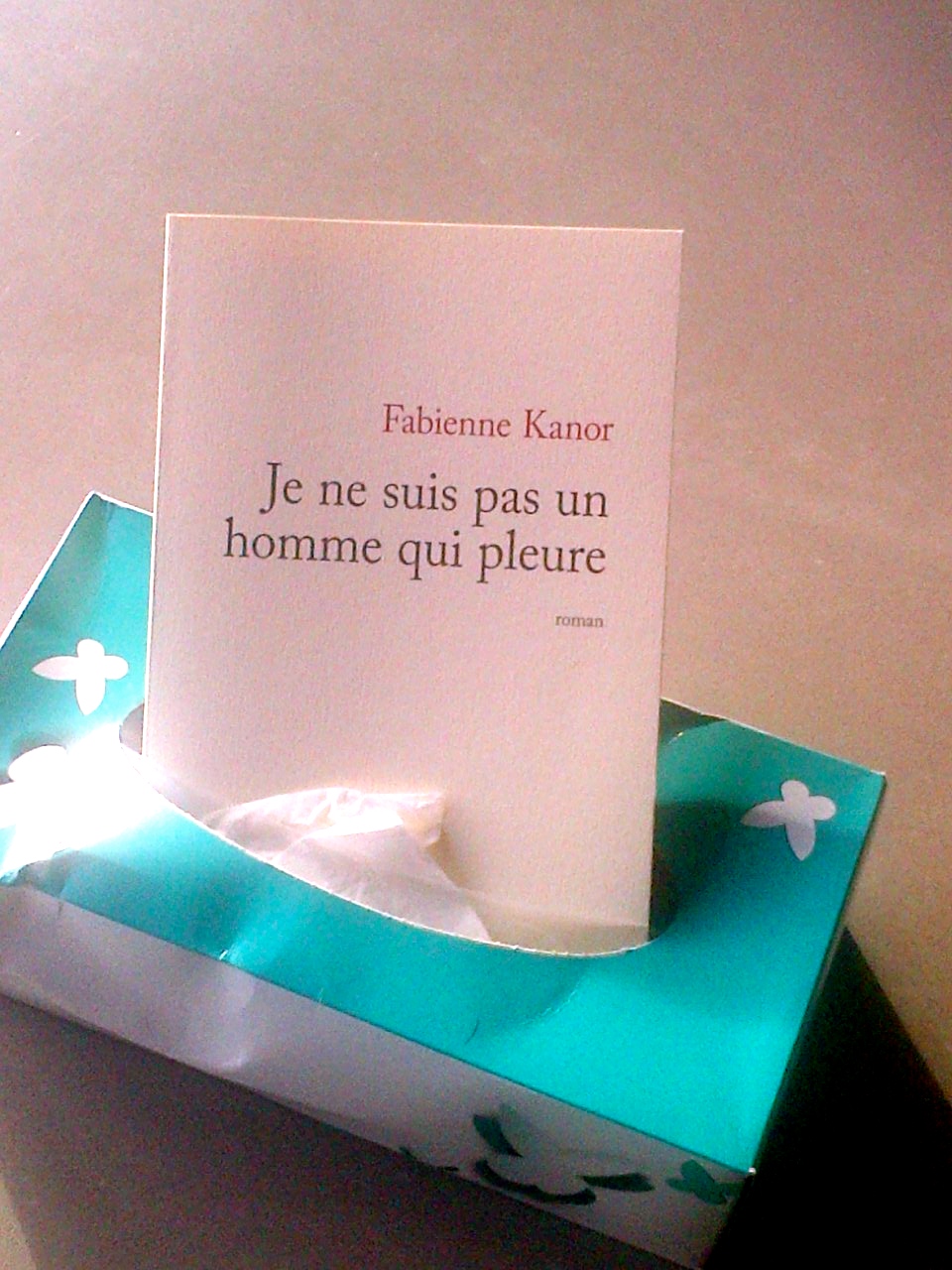La Maladroite, c’est l’adjectif qui qualifie Diana, à cause, entre autres, d’ « une trace au cou, un centimètre, et des rougeurs aux poignets et aux avant-bras, un gros bleu à la cuisse, un centimètre et demi de diamètre, un pouce qui fait mal –elle dit être tombée de vélo les deux mains en avant » (page 64).
Le calvaire de Diane va durer un peu moins de huit ans, puisque c’est à cet âge-là que les coups reçus vont définitivement broyer sa vie. Après avoir émietté les os, tordu les pieds, brûlé la peau.
La Maladroite* commence comme un fait divers dans la Voix du Nord, un petit chapelet de clichés : un milieu ouvrier, une jeune femme instable, sans doute devenue mère trop tôt, qui abandonne son enfant à la naissance, puis le récupère pour récupérer l’homme qui le lui a fait, puis la trimballe d’école en école, à chaque fois en fait que les institutrices, les directrices, les médecins et autres témoins, s’approchent de trop près l’effarante vérité. La Maladroite est un livre court, une trajectoire implacable, un désastre annoncé. On n’y trouve ni suspens, ni rédemption, ni explication, juste une écriture comme on cause, posée là, sortie, vomie parfois, de la bouche de ceux qui ont croisés l’enfant maladroit, qui n’ont rien pu faire – telle la deuxième directrice, tel l’aveuglement kafkaïen des services dédiés à l’enfance.
La Maladroite est un livre inclassable, entre documentaire et récit, un livre que la quatrième de couverture qualifie de « premier roman d’une rare nécessité ».
Il est une glaciale autopsie.
Il est un livre dont la seule violence est d’avoir montré comment la vie d’une petite fille vivante pouvait finir à la poubelle. Comme un jouet cassé.
*La Maladroite, d’Alexandre Seurat. Éditions du Rouergue, coll. « La Brune au Rouergue ». En librairie depuis août 2015.