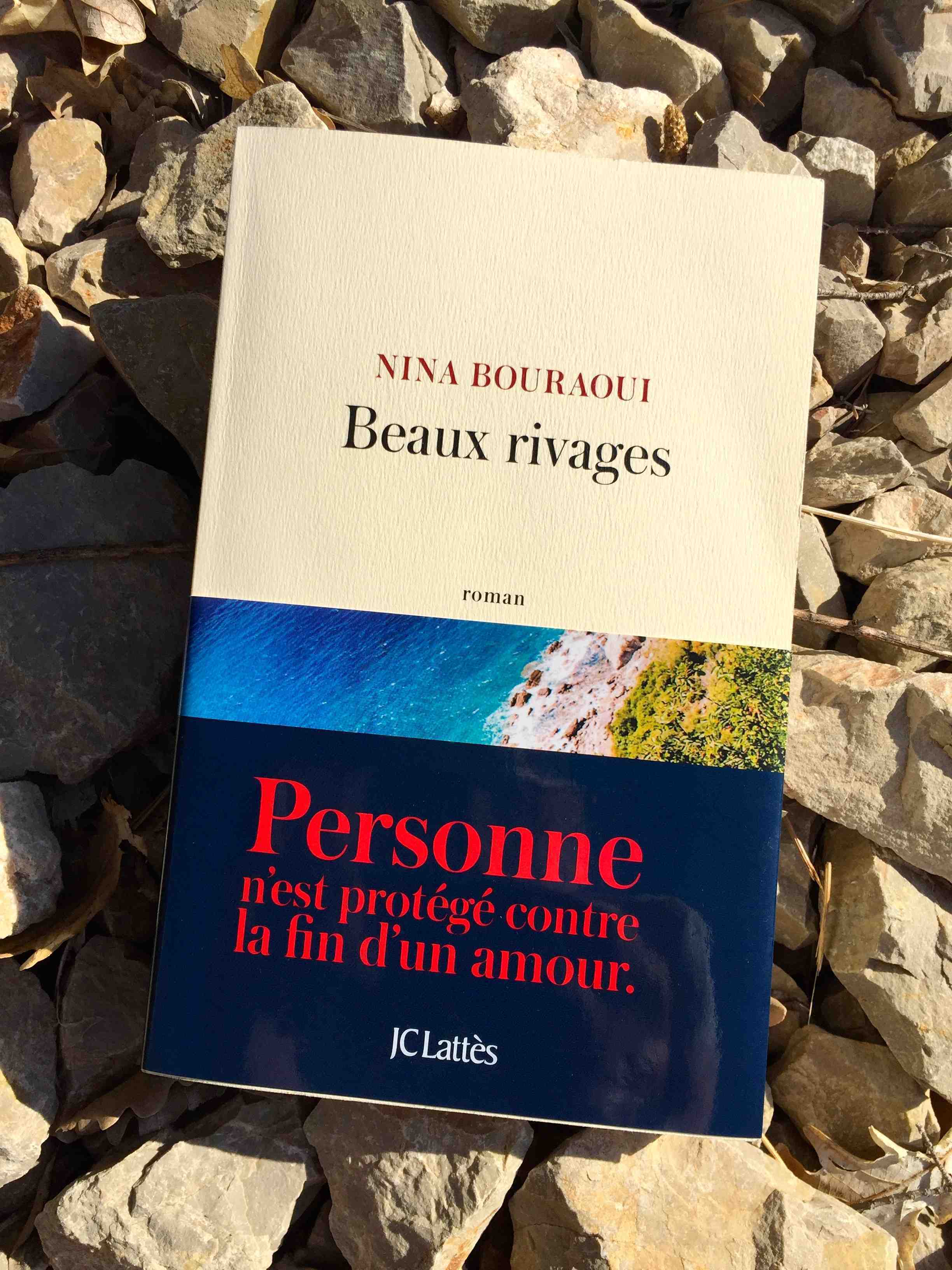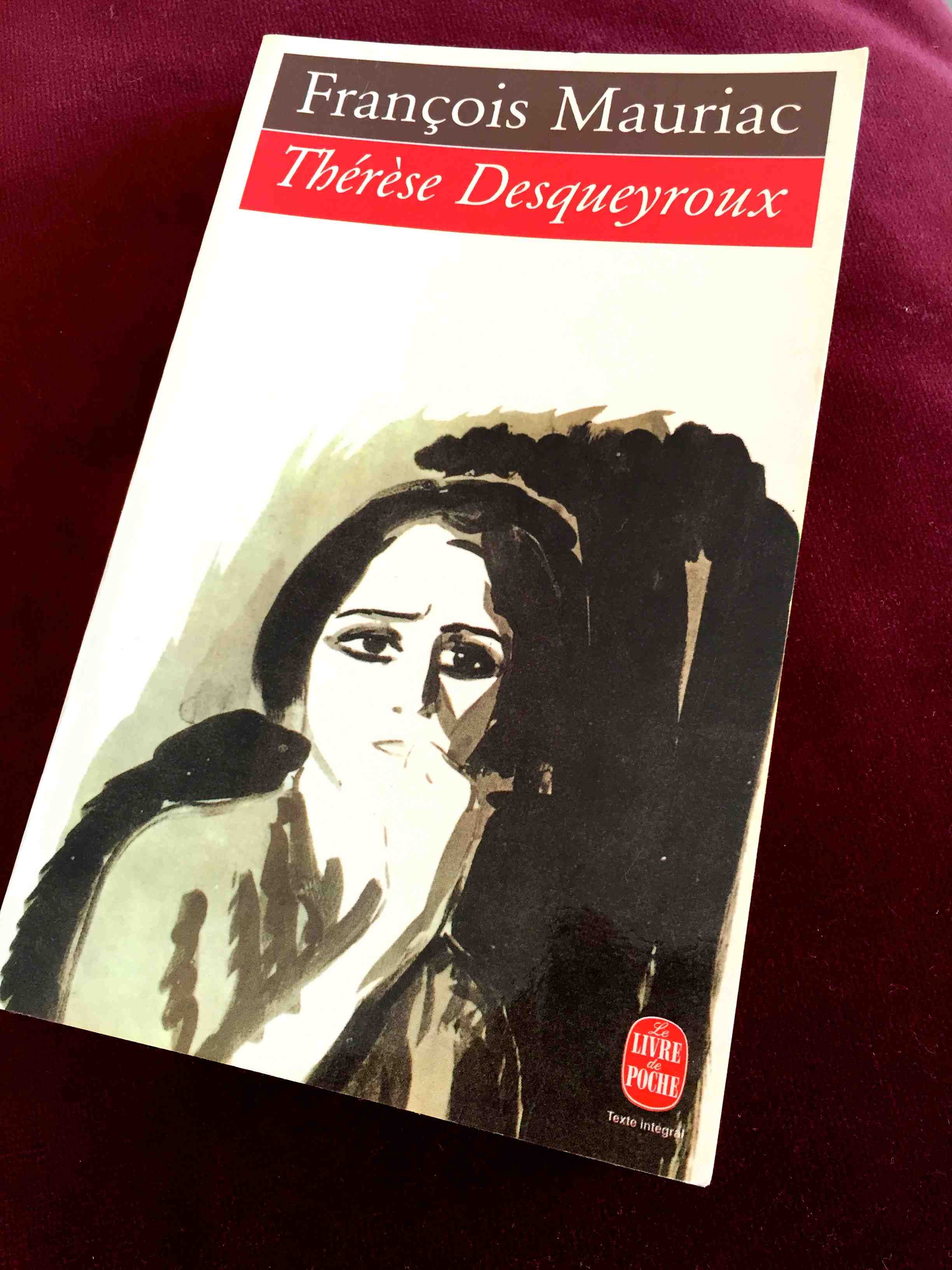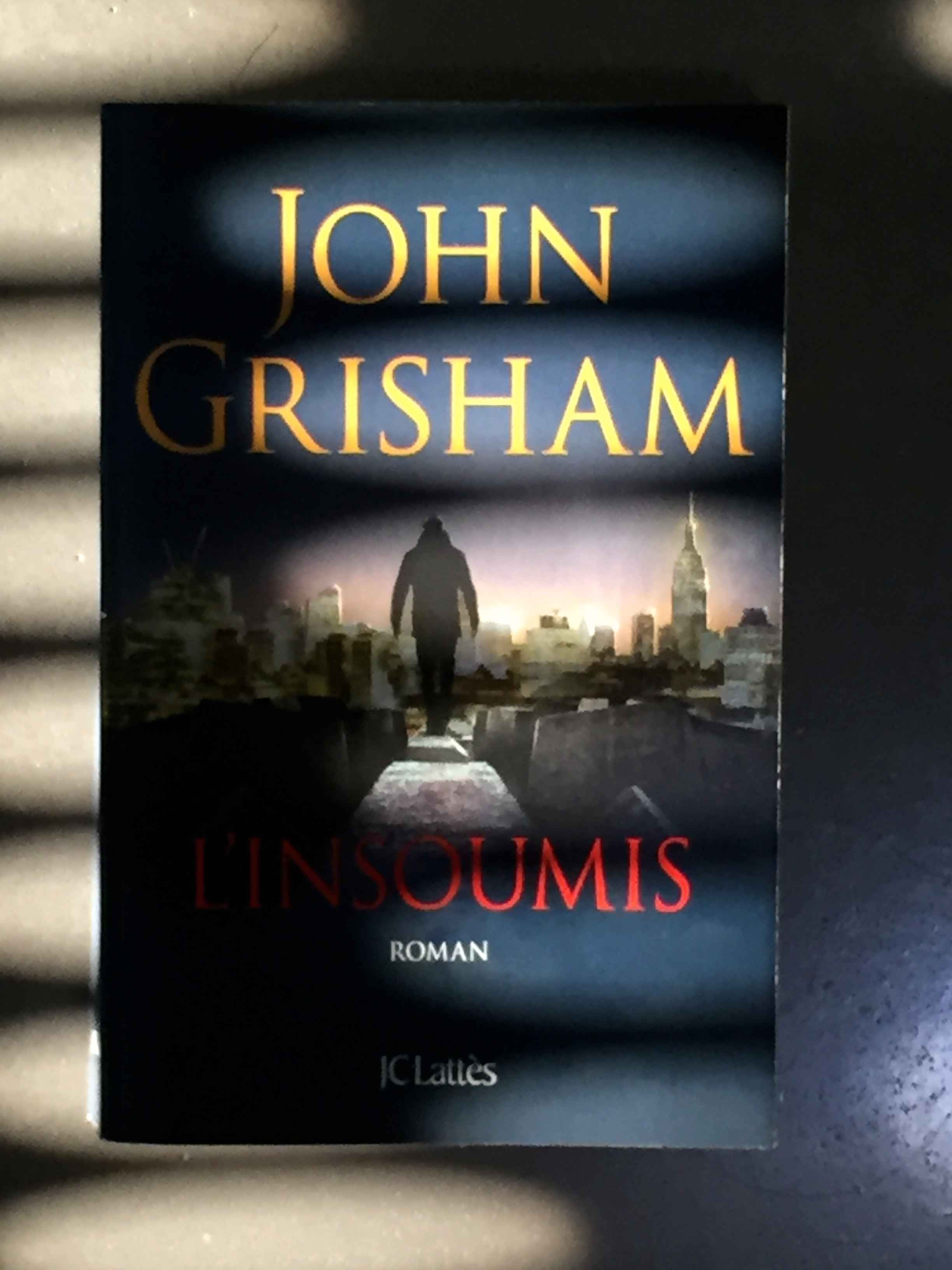Rentrée littéraire 2016. Les simples prétextes du bonheur est un vers emprunté à un poème de Forough Farrokhzad, l’une des premières poétesses iraniennes contemporaine à oser s’exprimer en tant que femme. Et c’est bien un magnifique portrait de femme que nous offre Nahal Tajadod avec son dernier livre* : l’histoire de Cécile Renan, riche et superbe – superbe, qui, selon l’auteur, définit ce qui « atteint l’un des plus haut degré de la perfection ».
Et si son personnage possède tout, absolument tout, il lui manque l’essentiel : ce petit bonheur, justement, qui bouleverse une vie et lui confère sa plus belle saveur – sa superbe raison d’être.
Ce bonheur-là, c’est la quête du livre.
Le point de départ : une épicerie iranienne au cœur de Paris, « à quinze minutes de la maison Chanel » (page 37).
La rencontre de ces deux mondes est une pièce d’orfèvrerie.
Mais comme Nahal Tajadod (née à Téhéran) est très loin de ces marchands de bonheurs à deux balles qu’on trouve à profusion dans les vitrines des librairies, c’est du côté du conte, de la poésie et finalement du fabuleux qu’elle va nous entraîner.
Il y a quelque chose de la bande des Valeureux d’Albert Cohen dans ses personnages : Kamal l’épicier, Arash, le médecin malgré lui, Jahed, la marathonienne qui court (enfin) à 4,3 km/h, et un mystérieux médecin perse qui soigne avec des bonbons au miel et à l’eau de rose ; des humanités magnifiques comme on n’en croise plus que dans les bons livres, ces personnages qui nous manquent singulièrement dans la vraie vie. Il y a des parfums, des épices et des rêves, dans ce roman. On y fait un voyage qui nous change à jamais et nous emporte dans l’immensité de nous-même.
Cette boule au ventre, ce nodule au sternum exactement (page 378), qui compresse la poitrine du personnage de Céline, c’est finalement notre inaptitude au bonheur qui se rappelle à nous.
Le grand talent de ce livre, outre une écriture virevoltante, ronde, riche comme un conte persan, et souvent tellement drôle, est de nous donner furieusement envie de nous rencontrer nous-mêmes. Ce qui est la seule façon de nous reconquérir.
*Les simples prétextes du bonheur, de Nahal Tajadod. Éditions Lattès. En librairie le 24 août 2016.