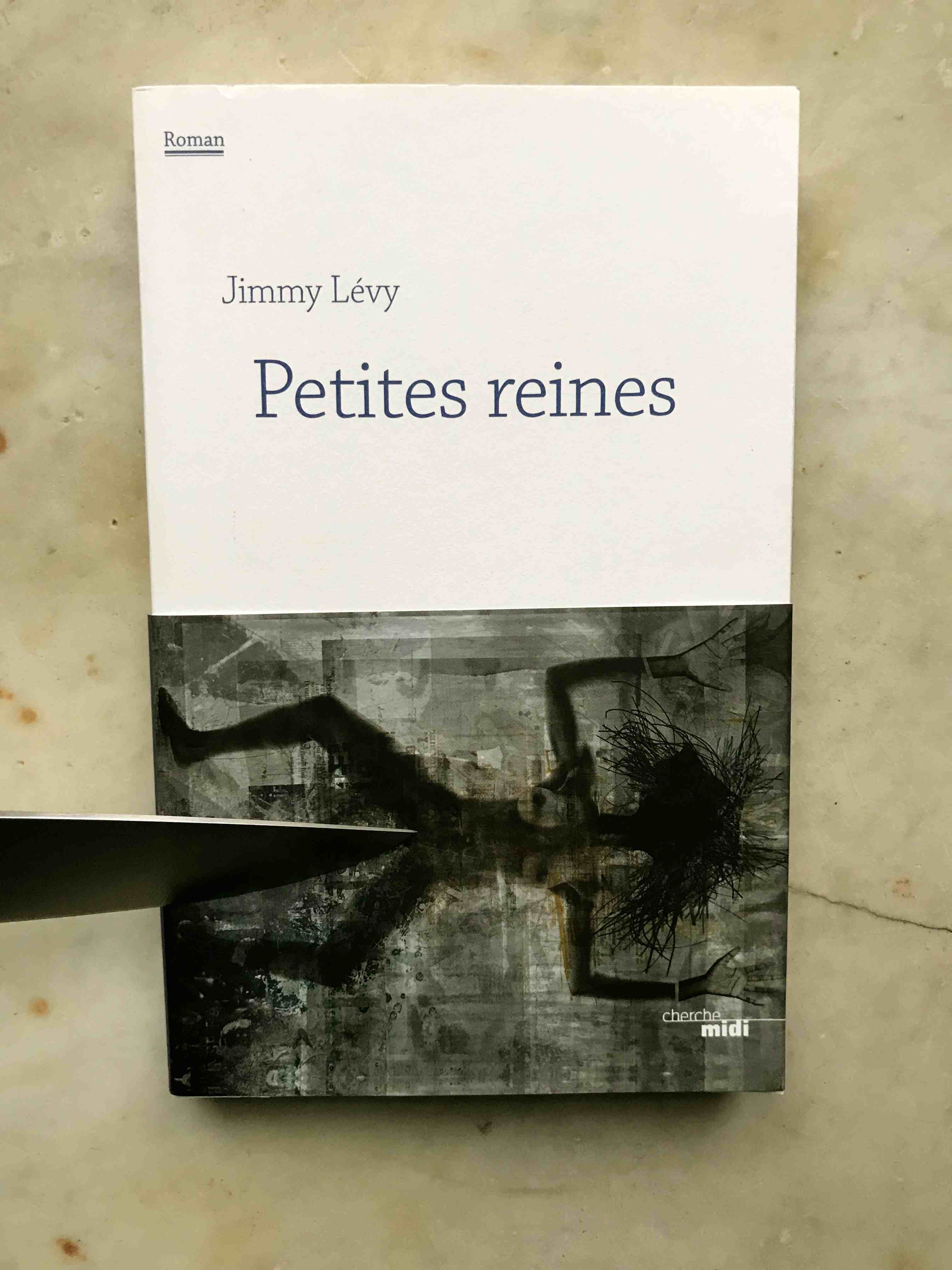Après le très scénaristique et philippedebrocaïen Belleville Shanghai Express paru en 2015, revoilà Philippe Lafitte avec un texte toujours mouvementé : Celle qui s’enfuyait*, un sujet à la frontière entre un hunt (un tueur poursuit quelqu’un) et une histoire de rédemption.
Après le très scénaristique et philippedebrocaïen Belleville Shanghai Express paru en 2015, revoilà Philippe Lafitte avec un texte toujours mouvementé : Celle qui s’enfuyait*, un sujet à la frontière entre un hunt (un tueur poursuit quelqu’un) et une histoire de rédemption.
Depuis quarante ans, Phyllis Marie Marvil, afro-américaine de soixante ans (« mais en fait à peine plus de quarante » – page 12), devenue auteur à succès de polars, fuit. Elle fuit jusqu’au moment où un coup de feu vient faire éclater le passé – car c’est toujours le passé qu’on cherche à tuer, il n’y avait que dans le cultissime Terminator que l’on cherchait à tuer le futur.
Dans ce roman inclassable (thriller psychologique et ode à la littérature et roman historique – les années Viêt Nam sont déjà de l’histoire –), Philippe mélange les genres, brouille joyeusement les pistes, et invente, pour notre plus grand plaisir de lecteur/spectateur, un style à la croisée d’un roman américain, d’une série télé et d’un film à la Clint Eastwood.
On l’aura compris, Philippe explore cette fois-ci les années soixante-dix, ces très sombres années américaines qui virent le racisme détruire tout un pays, fracturer davantage une société déjà blessée, enflammée, et exhume un sujet rare dans notre littérature romanesque française : l’émergence d’une ultra gauche américaine militante, active, armée. (Je me souviens que Marc Levy, en 2014, s’était emparé du sujet dans le plus sombre qu’ici et très efficace aussi Une autre idée du bonheur).
Bref, Celle qui s’enfuyait mérite que vous couriez jusqu’à la librairie la plus proche, puis rentriez, éteigniez votre téléphone et plongiez dans ses 25 chapitres comme dans les 25 épisodes d’une série addictive.
*Celle qui s’enfuyait, de Philippe Lafitte. Éditions Grasset. En librairie depuis le 7 mars 2018.
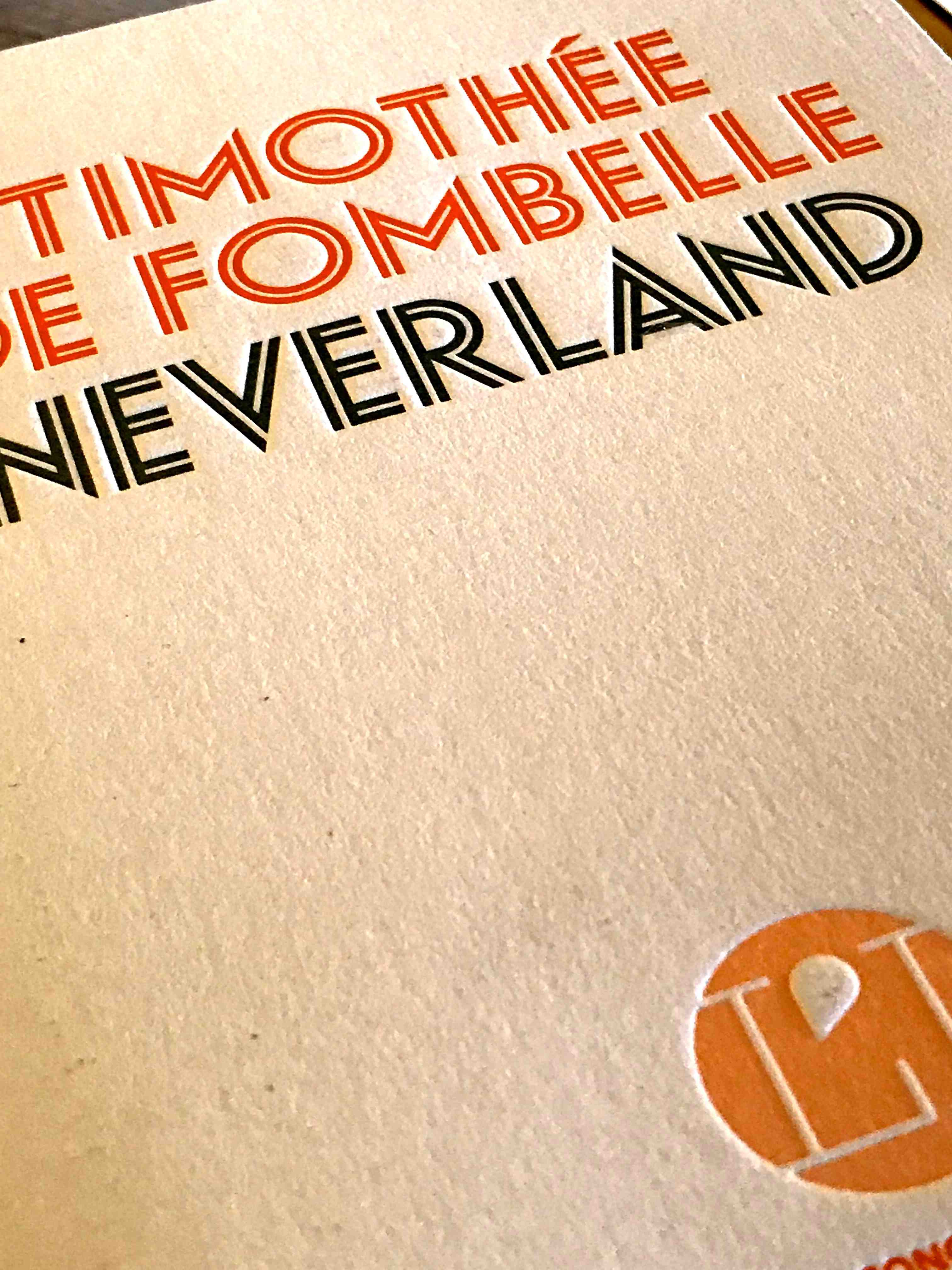
 Voici un étonnant opuscule au titre qui pourrait laisser supposer une histoire pour enfants, Tonton Lionel*, deux petits mots presque rigolos centrés sur une couverture vide mais qui, dès celle ci soulevée, fait apparaître tout autre chose, et nous voilà tout surpris alors que le titre, le vide, nous annonçaient pourtant la couleur, mais pressés que nous sommes toujours, nous n’y avions pas prêté garde.
Voici un étonnant opuscule au titre qui pourrait laisser supposer une histoire pour enfants, Tonton Lionel*, deux petits mots presque rigolos centrés sur une couverture vide mais qui, dès celle ci soulevée, fait apparaître tout autre chose, et nous voilà tout surpris alors que le titre, le vide, nous annonçaient pourtant la couleur, mais pressés que nous sommes toujours, nous n’y avions pas prêté garde.