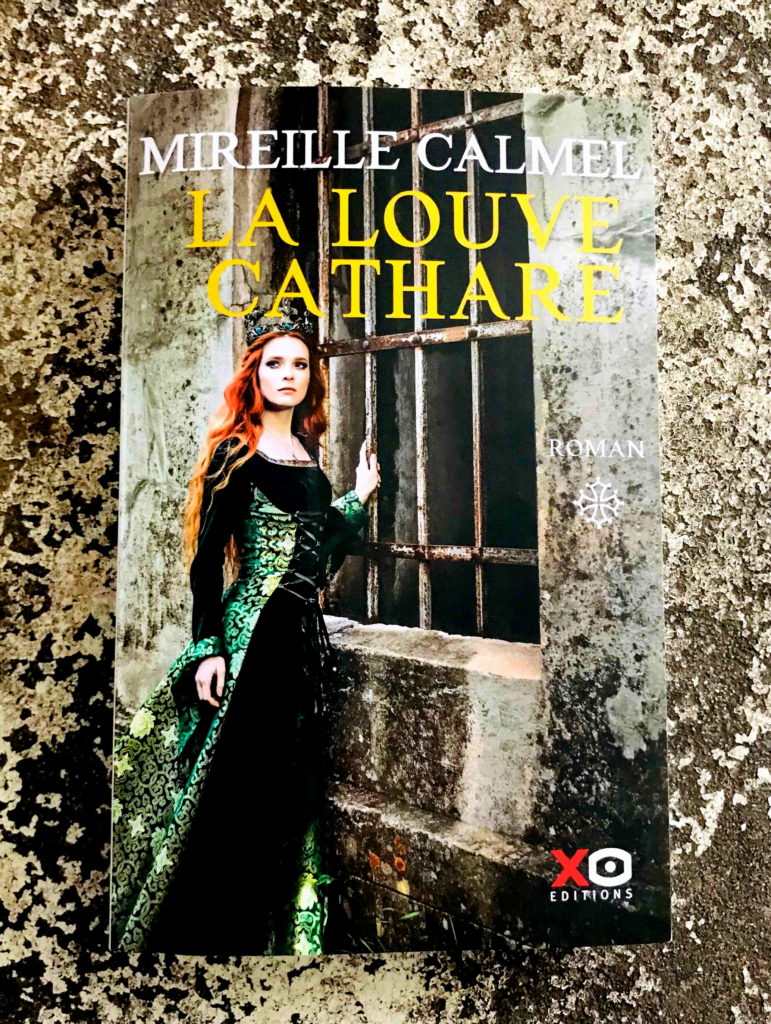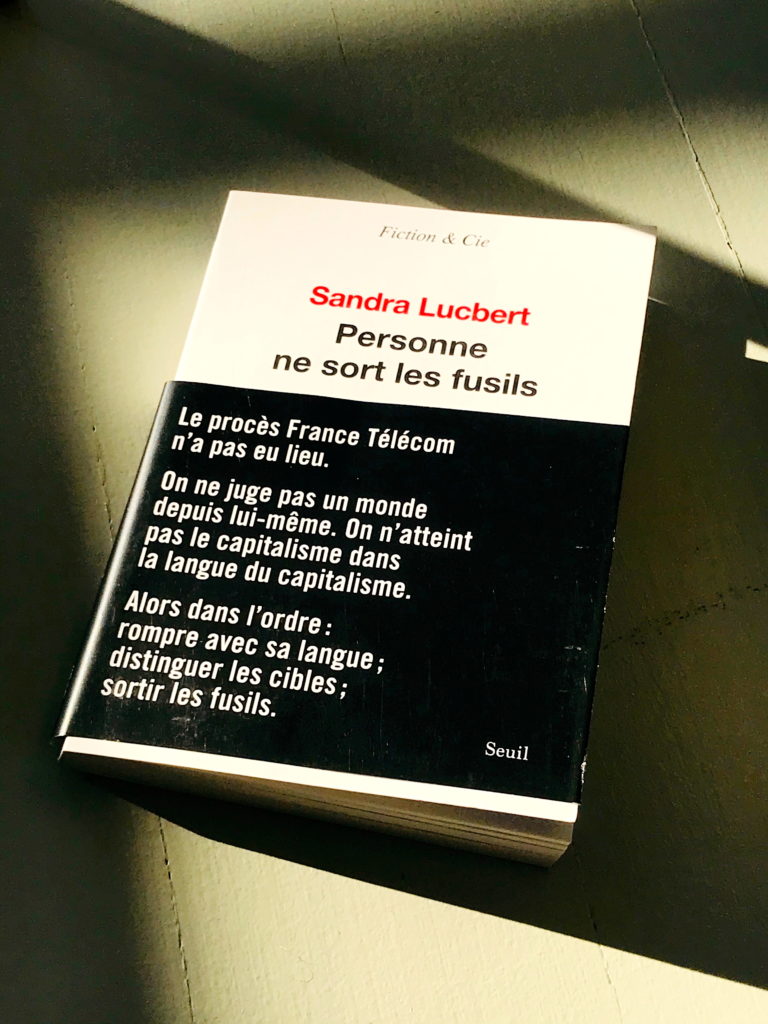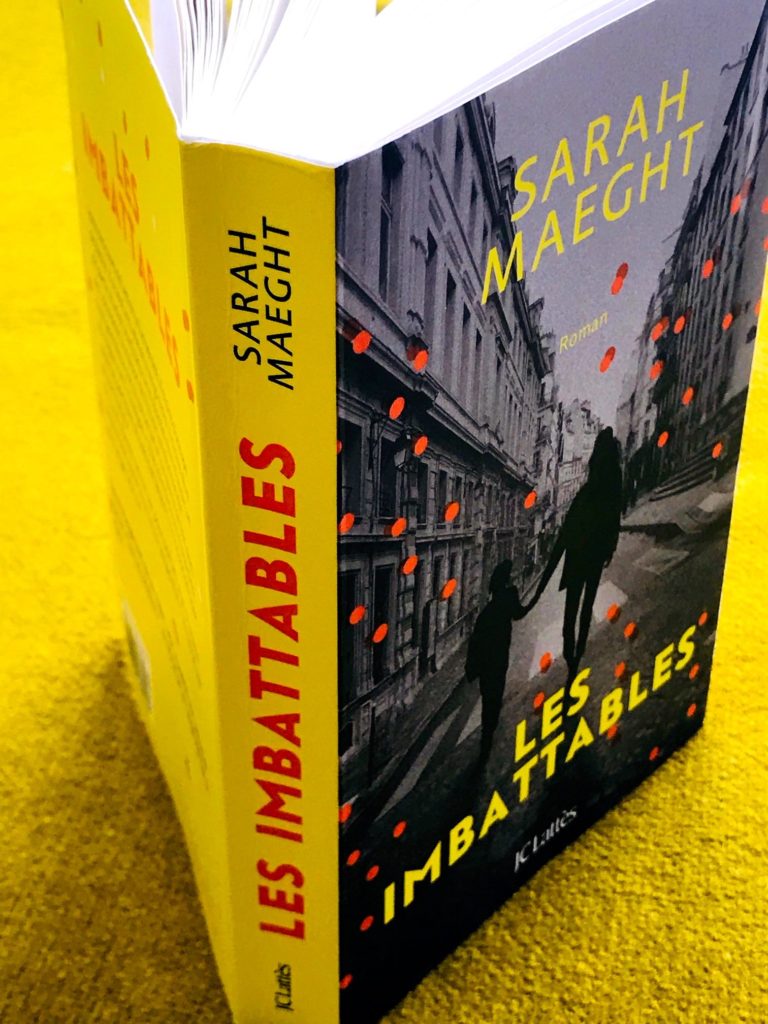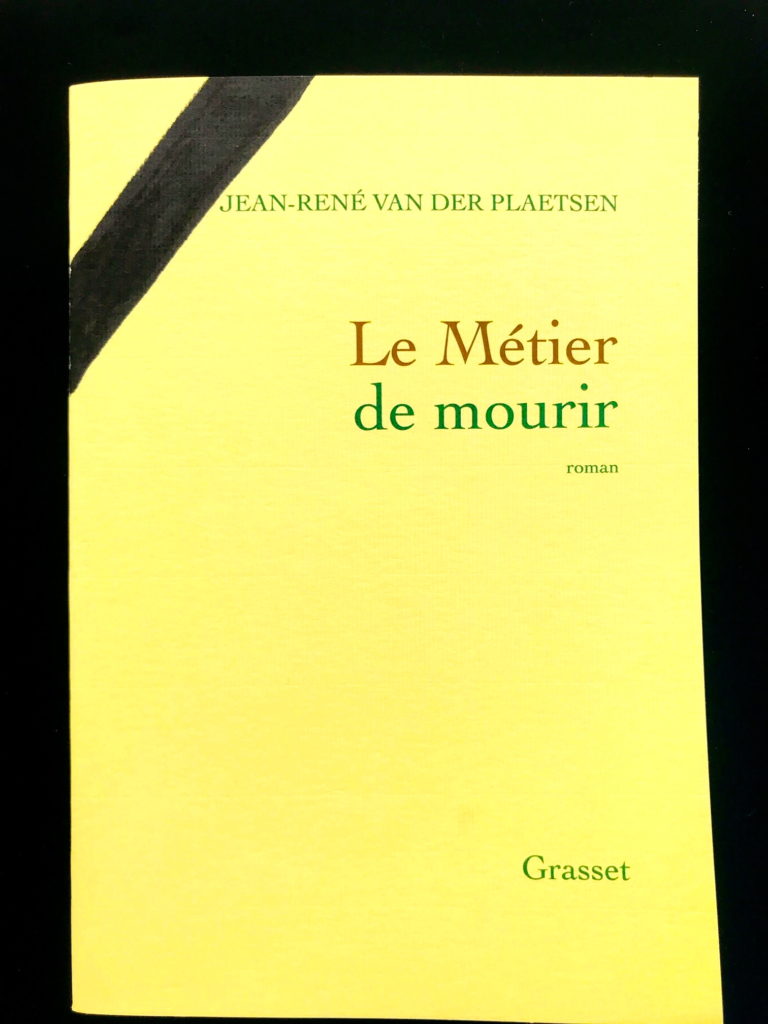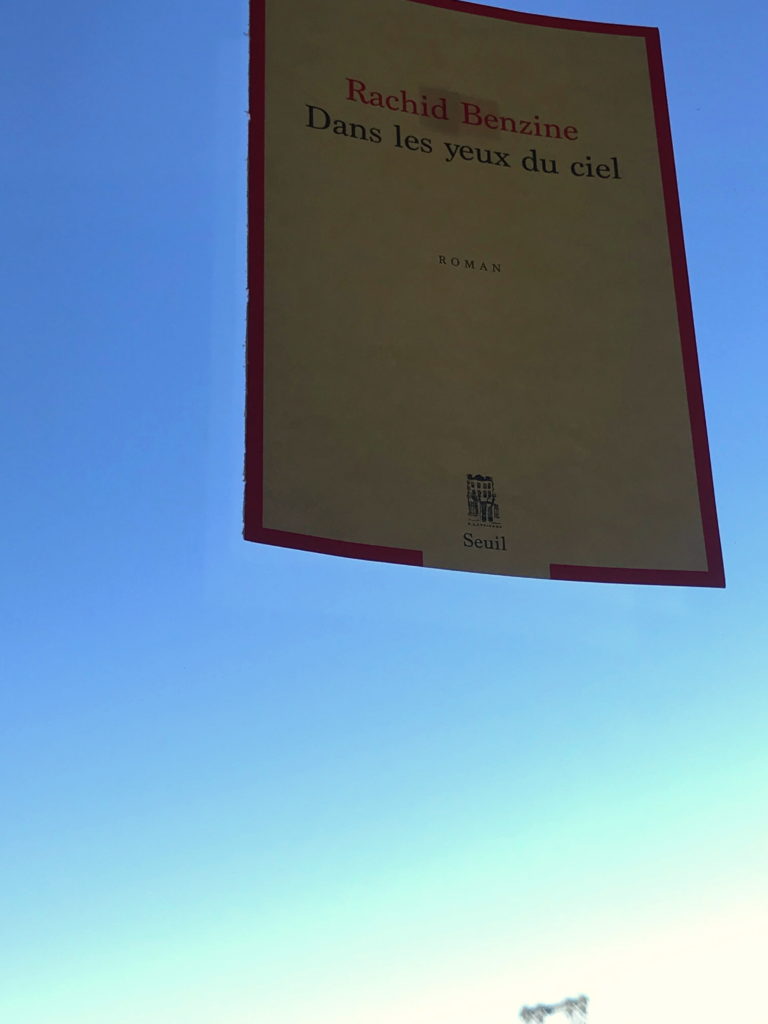De quoi 2021 est-il fait ? Voici un texte précieux. Délicat. Plein de grâce. Une errance dans l’enfance comme celles, parfois, de Erri de Luca. Dans son dernier livre*, Andreï Makine nous raconte une amitié de jeunesse, deux orphelins dans une institution de Sibérie, l’un protège l’autre, affaibli par une mystérieuse maladie, de la méchanceté des autres gamins. Il n’en faut pas plus pour que ce déroule ce voyage dans un quartier sans beauté où s’est installée une communauté d’Arméniens afin de rester proches de leurs amis emprisonnés loin de leurs terres. Voici le petit « Royaume d’Arménie » où l’on vit de souvenirs, de parfums et d’espoirs et où l’amitié de ces deux gamins, Vardan et le narrateur, va changer à jamais la façon d’être un homme. Quel dommage que l’immense Robert Mulligan ait eu la mauvaise idée de nous quitter il y a deux ans déjà, il aurait fait de cet Ami arménien, un film d’une sublime poésie.
*L’Ami arménien, de Andreï Makine. Éditions Grasset. En librairie le 6 janvier 2021.