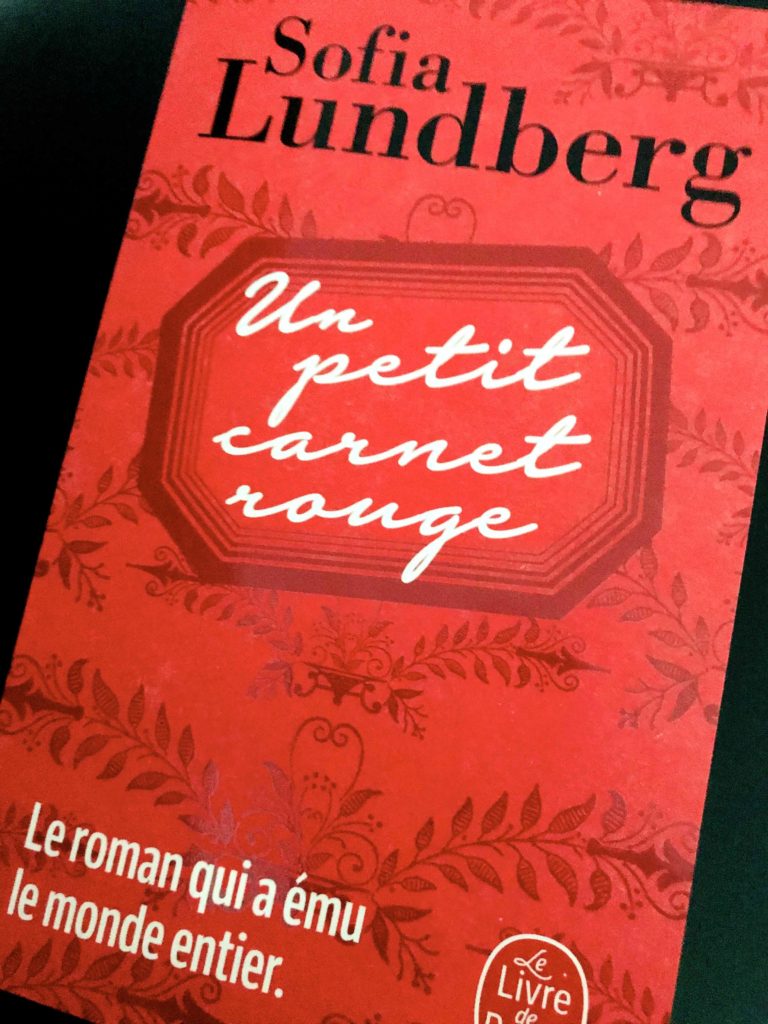Je me souviendrais toujours du dixième épisode du documentaire de Karlin et Lainé en 1989, L’amour en France, un « essai sur la sexualité des français », parce que celui-ci mettait en scène un crime passionnel (on n’emploie plus beaucoup cette qualification aujourd’hui) au travers du témoignage, dans sa cellule de prison, d’un type de 27 ans qui avait tué sa maîtresse de 33 coups de couteaux dans le dos et une dizaine dans la tête, au prétexte qu’elle avait ri parce que, bourré, il ne parvenait pas à bander. Je voulais tuer ce rire, dira-t-il. Ou ai-je imaginé. Toujours est-il que cette seconde où tout bascule m’a toujours fasciné, inspirée pour certains de mes textes.
Et voilà qu’un jour, je croise la comédienne Sophie Daull dans un salon du livre où elle présentait son premier livre, Camille mon envolée (2016), d’une merveilleuse délicatesse, dans lequel elle parlait à sa fille décédée seize jours plus tôt, et j’apprends à cette occasion qu’elle est elle-même la fille de la femme assassinée de 33 coups de couteaux.
La foudre frappe bien deux fois au même endroit.
Dans son dernier livre, Au grand lavoir, Sophie imagine sa rencontre avec Philippe Debois, le meurtrier de sa mère, dans une librairie où elle dédicace son dernier ouvrage. Elle tente de dénouer les fils complexes du viandard, sans compassion ni haine, ce qui rend le gaillard encore plus glaçant. Ce texte court qui mêle avec grâce fiction et réalité nous tisonne et nous renvoie à l’insoluble question : que ferait-on devant l’assassin de notre mère ? Grande claque.
*Au grand lavoir, de Sophie Daull. Édition Philippe Rey (2018). Puis au Livre de Poche depuis le 2 janvier 2020. Prix de littérature de l’union européenne.