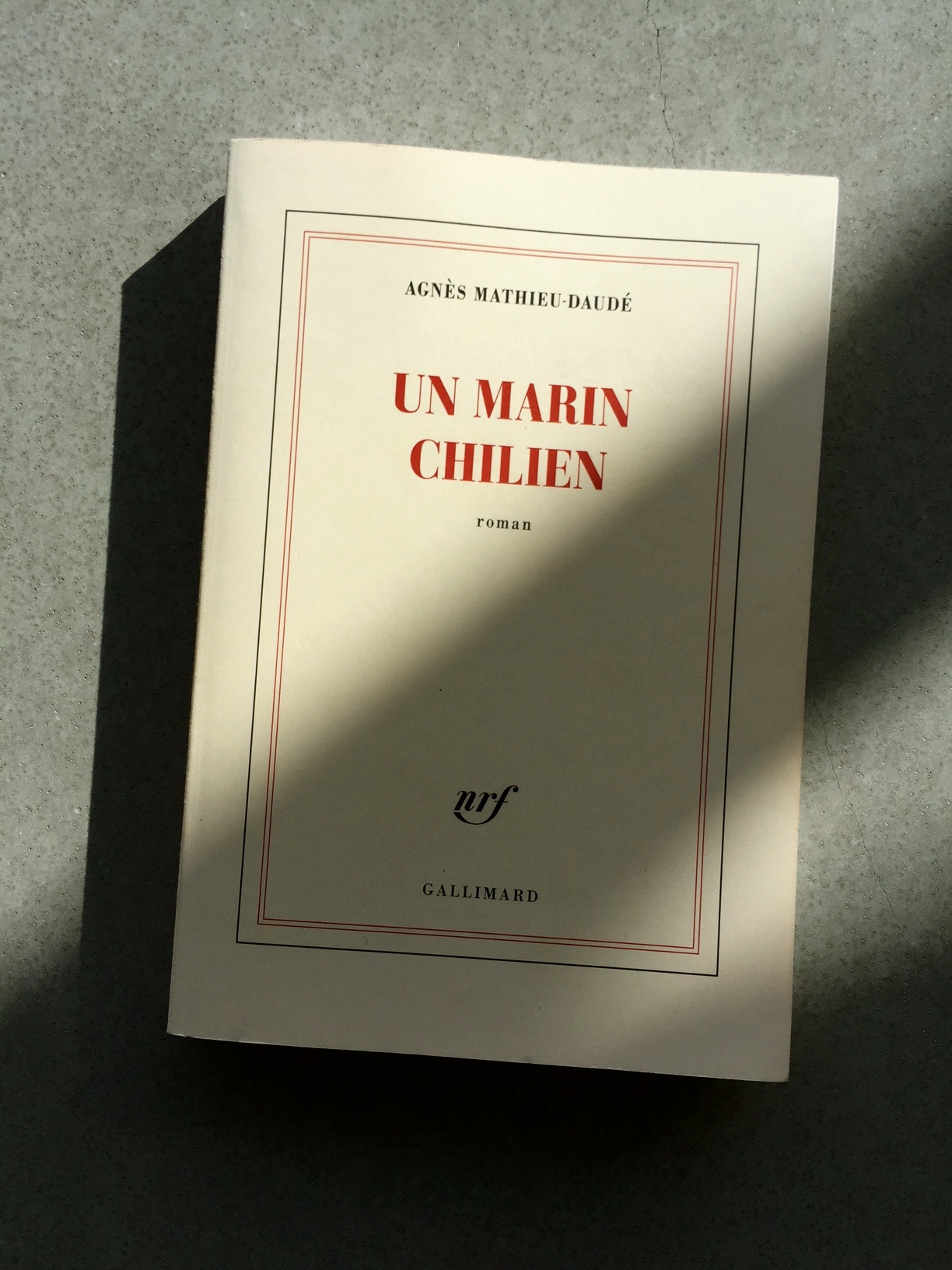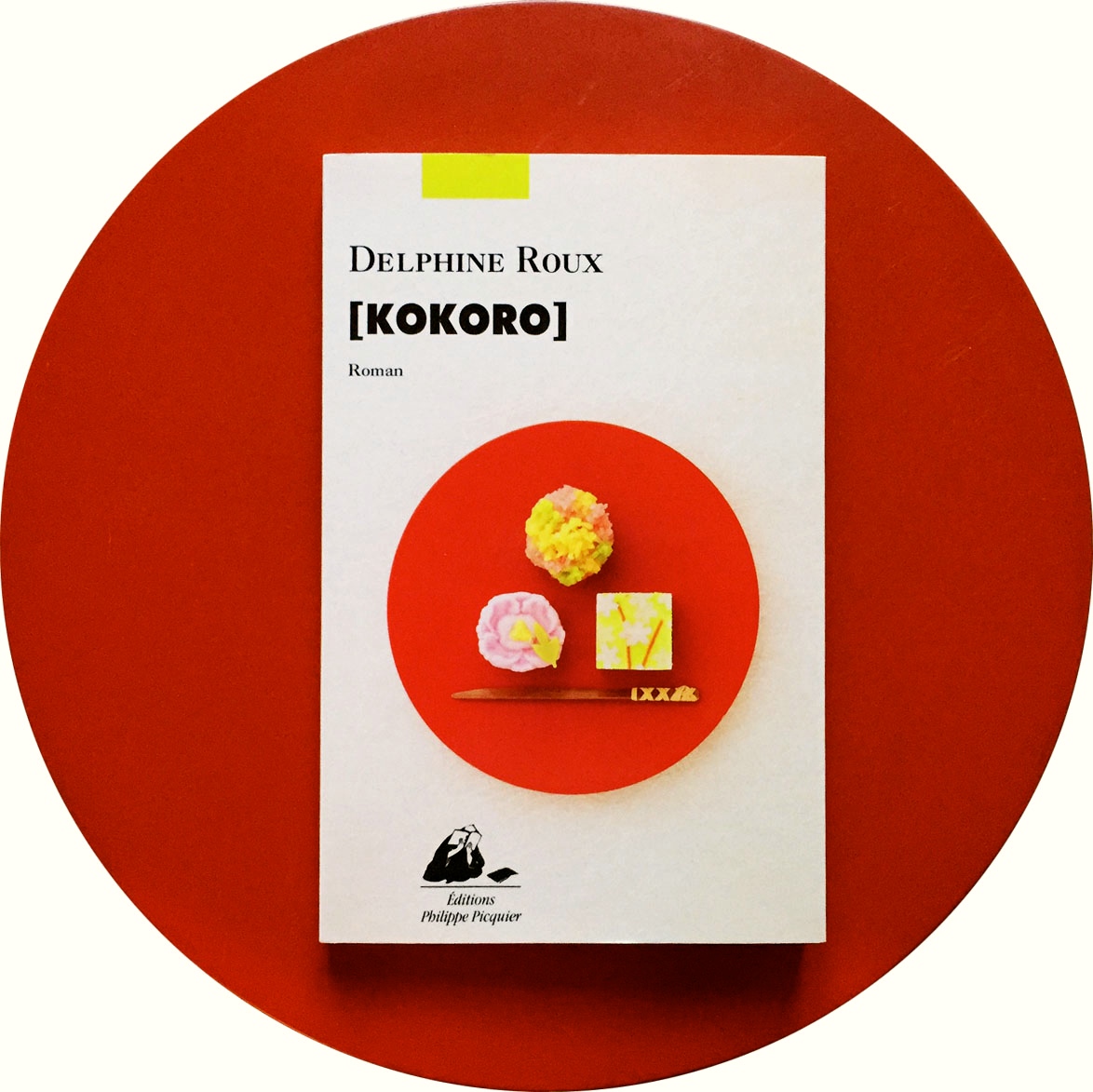Amélie Antoine est lilloise. Il est écrit quelque part qu’elle est une jeune trentenaire (dit-on vieille trentenaire pour une jeune quadragénaire ?). Elle a écrit un roman (en un mois, est-il aussi écrit toujours quelque part) qu’elle a, en mars 2015, publié directement sur Amazon.
Moins d’un an après, 25.000 personnes* l’avaient lu et étaient, semble-t-il, assez enthousiastes.
Un an plus tard, repéré par l’éditeur Michel Lafon, son texte sort en version papier**.
On a connu quelques belles histoires de ce genre, la plus célèbre étant « 50 Nuances de Grey » que James avait commencé à publier sur un blog.
Un adorable mail de l’auteur, ainsi que cette histoire de succès sur Internet, il ne m’en fallait pas plus pour lire le livre.
Eh bien, c’est bien. Fidèle au poste appartient à cette famille qui va de « Et si c’était vrai ? » à « Je suis là », en passant par « Une éternité plus tard », mais le texte d’Amélie Antoine possède en plus quelque chose qui me gratouille : un cynisme à l’anglo-saxonne, une irrévérence sombre, qui en font sa modernité.
Plus qu’un livre, c’est avant tout une histoire, mais une histoire bien troussée, rapide, rebondissante, un vrai moment d’entertainment. Et c’est aussi ça, finalement, un livre.
* Pour info, un premier roman qui se vend à 3000 exemplaires est un succès. 10.000 un triomphe. 25.000, une biture carabinée.
**Fidèle au poste, Amélie Antoine. Éditions Michel Lafon. En librairie depuis le 3 mars 2016.