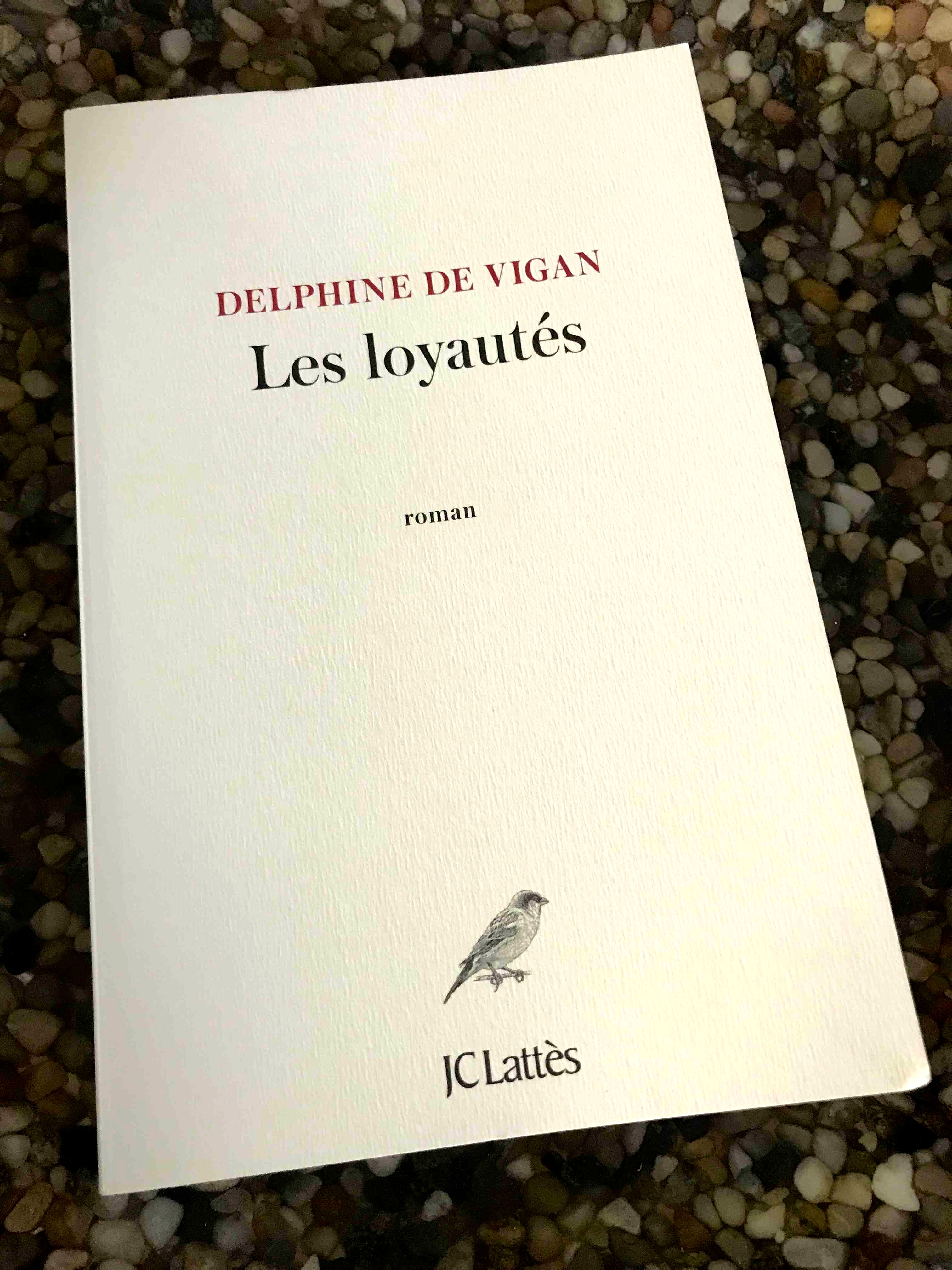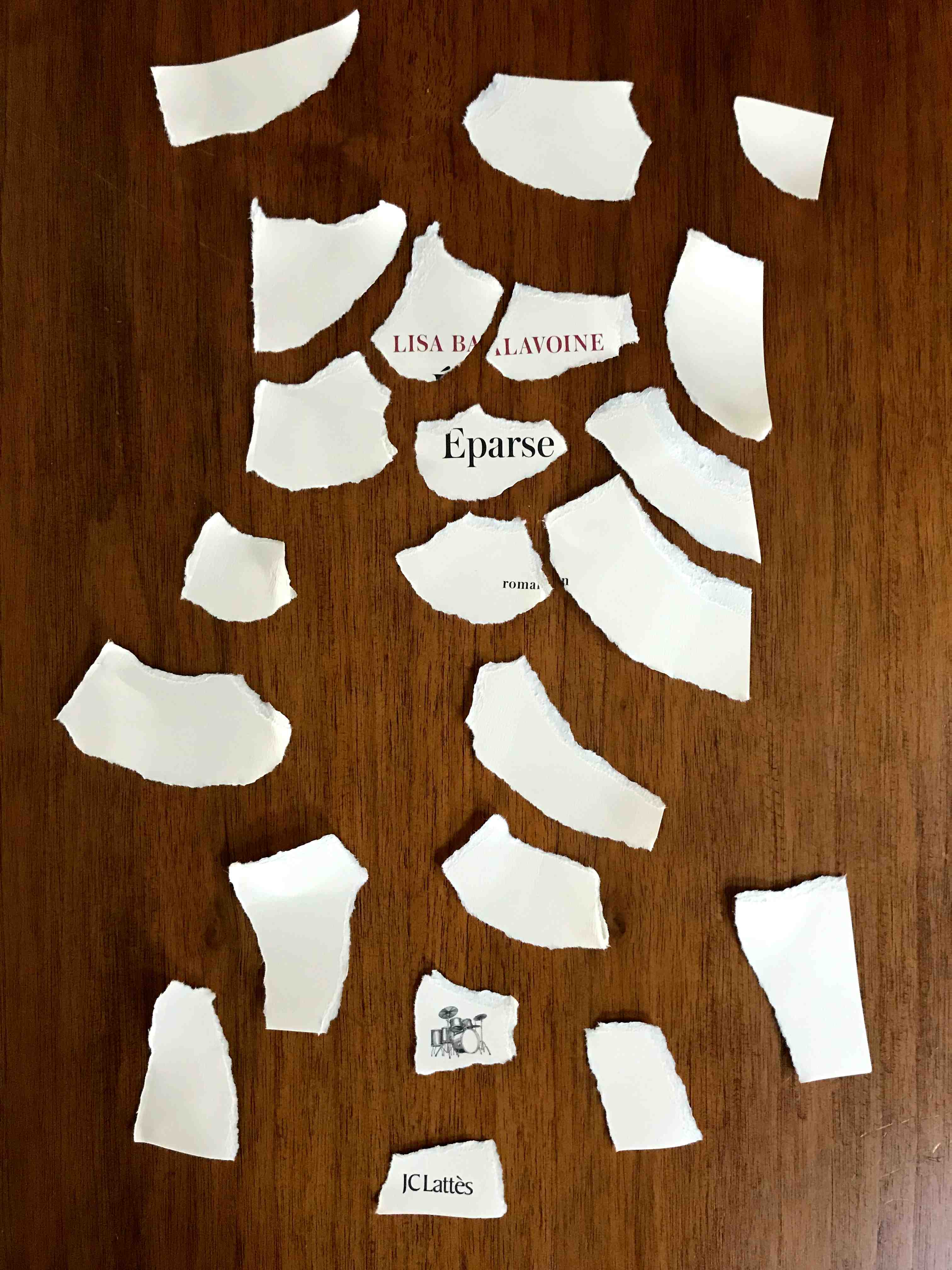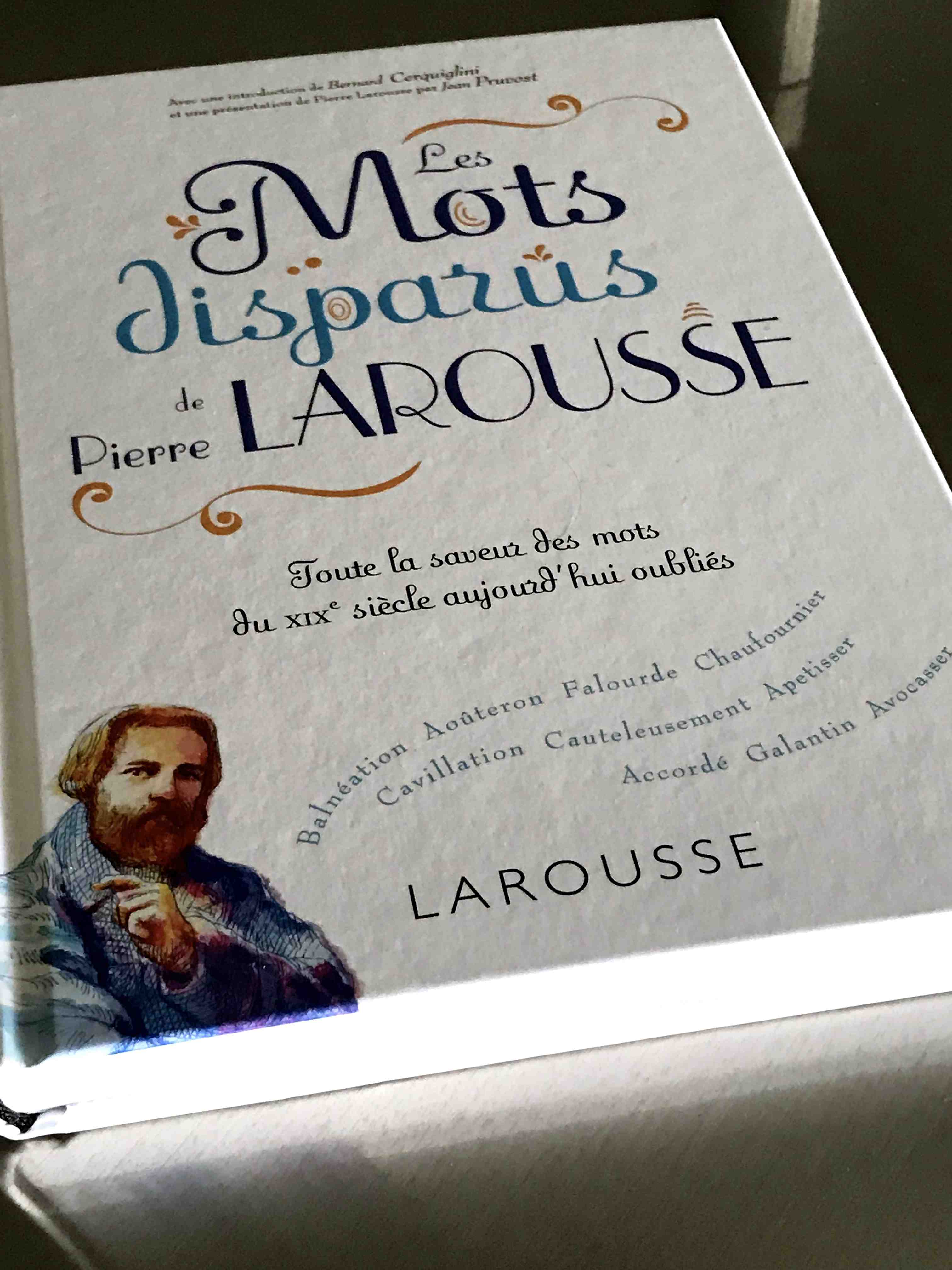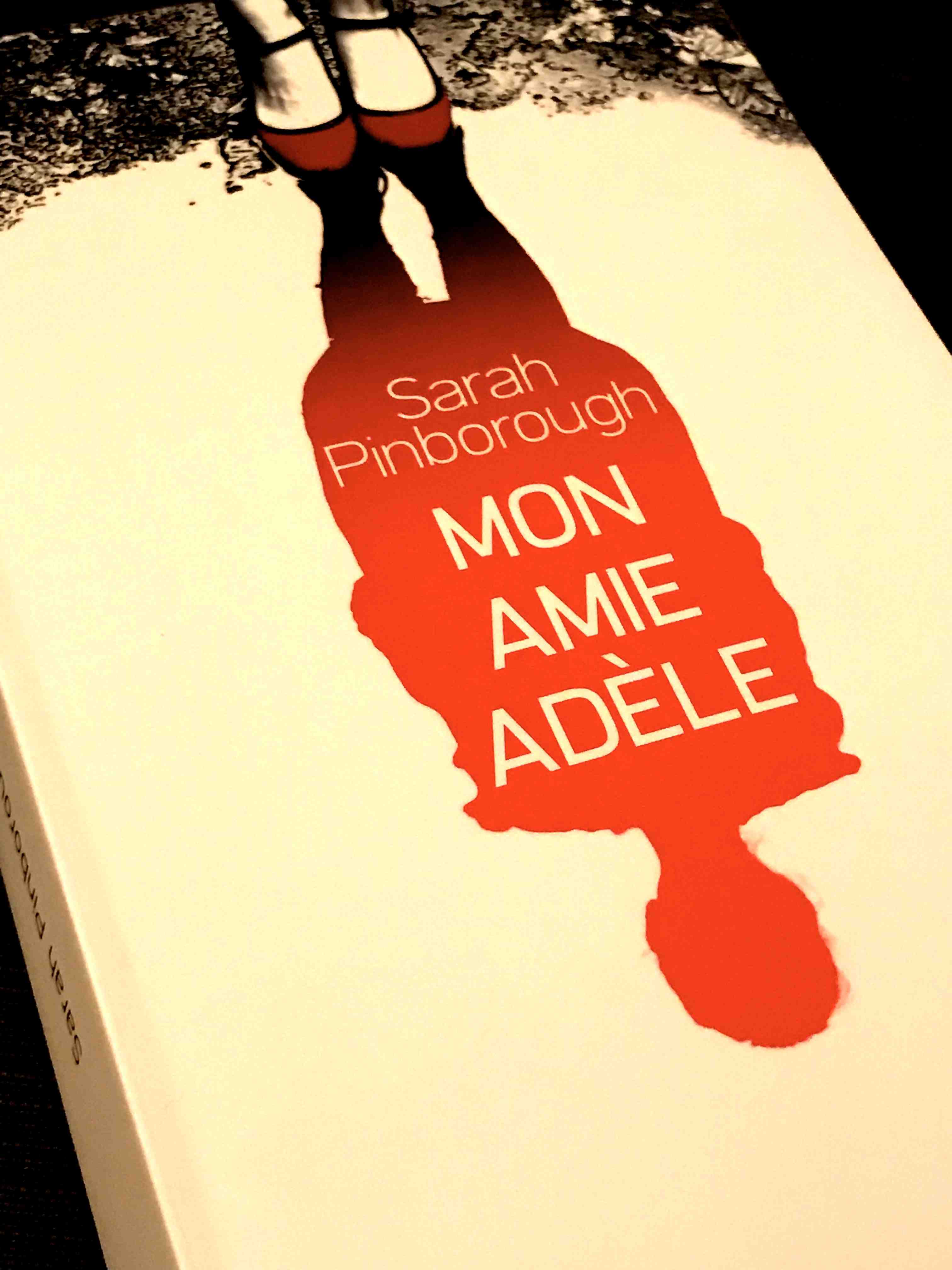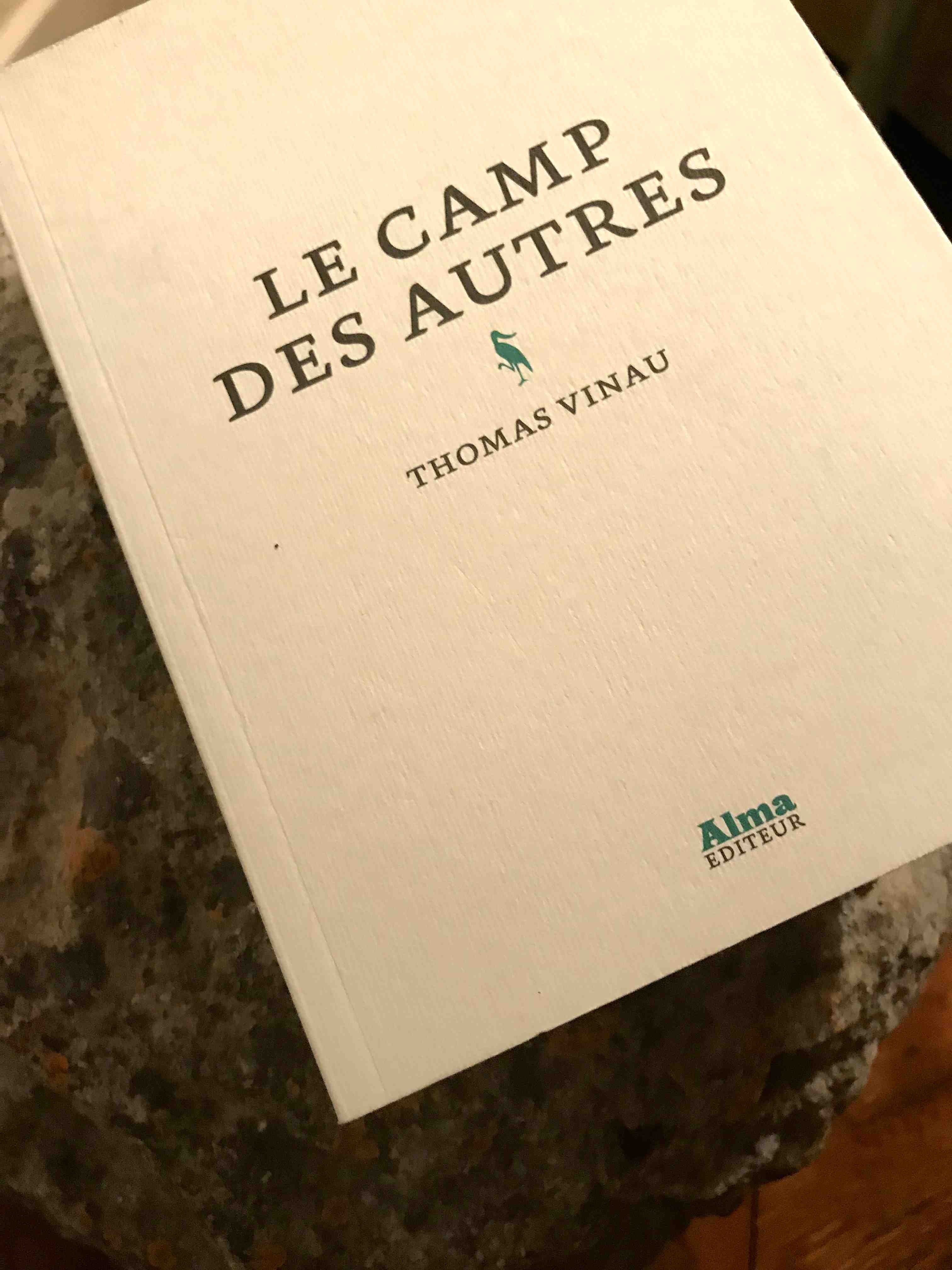Entre Noël et le jour de l’an (date à laquelle j’ai eu la joie de découvrir La Soie du sanglier*), c’est la saison des cadeaux et autres remerciements. Je remercie donc Emmanuelle de nous avoir offert deux livres pour le prix d’un. L’un pourrait s’appeler La Soie. L’autre, Le Sanglier. Le Sanglier met en scène la vie rugueuse d’un type rugueux dans la rugueuse Dordogne – Bernard ; une France ancienne, sauvage, où dès l’aube l’alcool coule dans les veines et charrie toutes les misères, les désillusions, quelques espoirs aussi ; des bois où ombres et « peuples discrets de l’herbe » se mélangent, des battues où des balles ricochent curieusement et viennent parfois se planter dans une gorge d’homme pour le faire choir ; une plaine où les rancœurs sont tenaces et les vengeances longues ; un pays littéraire où ressurgissent des mots oubliés, amandines, rosabelles, babouillis, grenu, chevêches, etc, toute une symphonie pastorale envoutante ; un livre qui raconte enfin qu’ici l’amour ne dure pas, s’évanouit aux premiers dégels et plonge Bernard dans l’abandon, le vide d’Isabelle, dans davantage d’alcool encore, davantage de solitude encore. Et puis, La Soie. Le cadeau. Le retournement des choses. L’improbable et délicate rencontre entre notre sanglier cinquantenaire et bourru avec l’élégante aristocrate esseulée, Marie, soixante-quinze ans (préfigurant ce à quoi ressemblera notre couple présidentiel dans dix ans) ; un Harold et Maud terrestre, une rencontre au-delà du temps, du vin qui coule et du pastel des toiles qu’elle peint ; les retrouvailles en somme de deux perdus en ce pays, celui du désir, celui du corps, d’une cicatrice de césarienne qui tourne comme la Dordogne au cingle de Trémolat.
Mais chut. Laissons les faire connaissance maintenant, dans le noir, dans le silence, dans la joie.
*La Soie du sanglier, d’Emmanuelle Delacomptée. Éditions Lattès. En librairie le 10 janvier 2018.