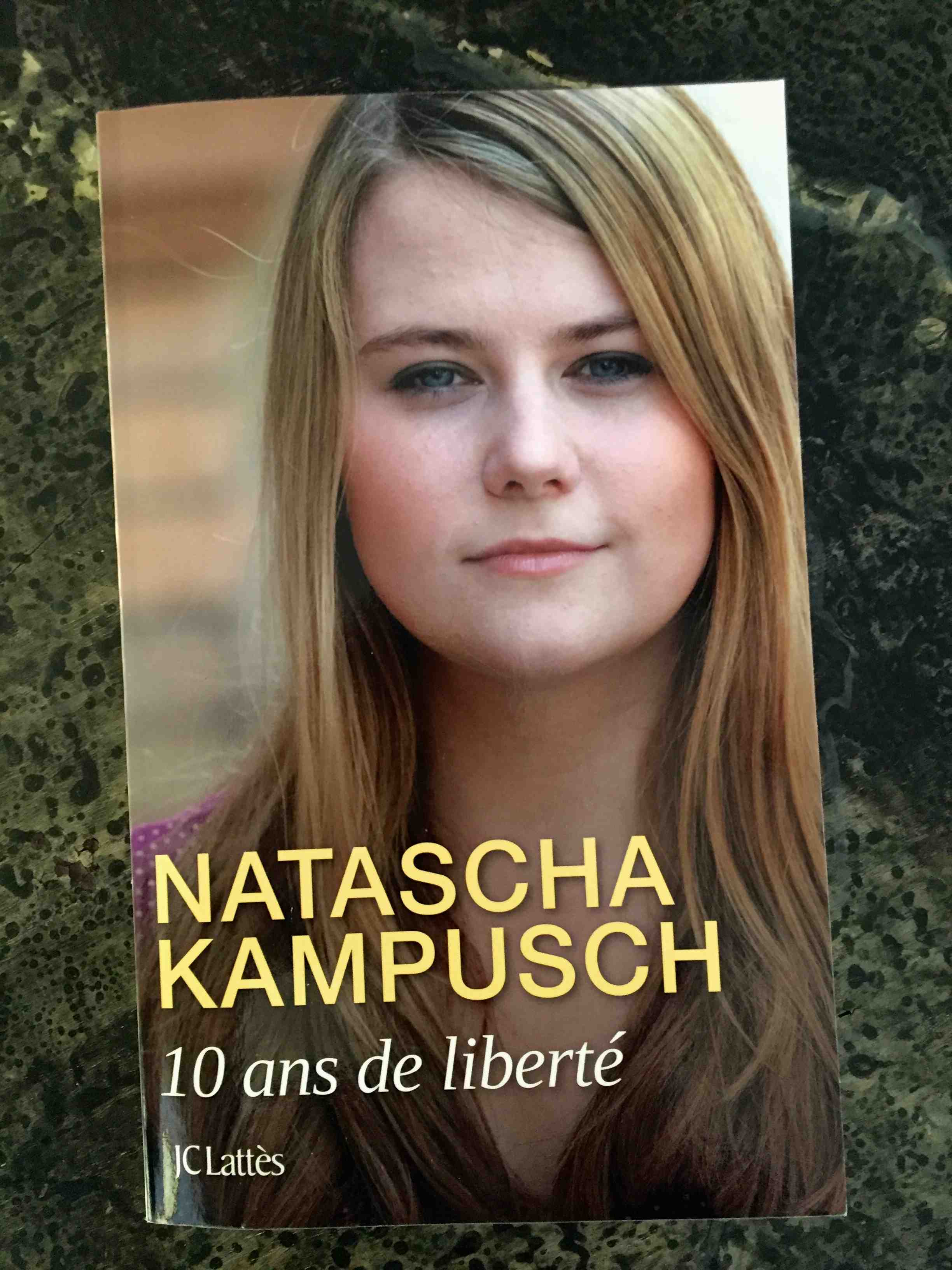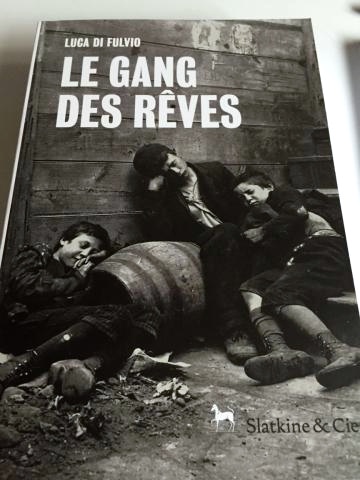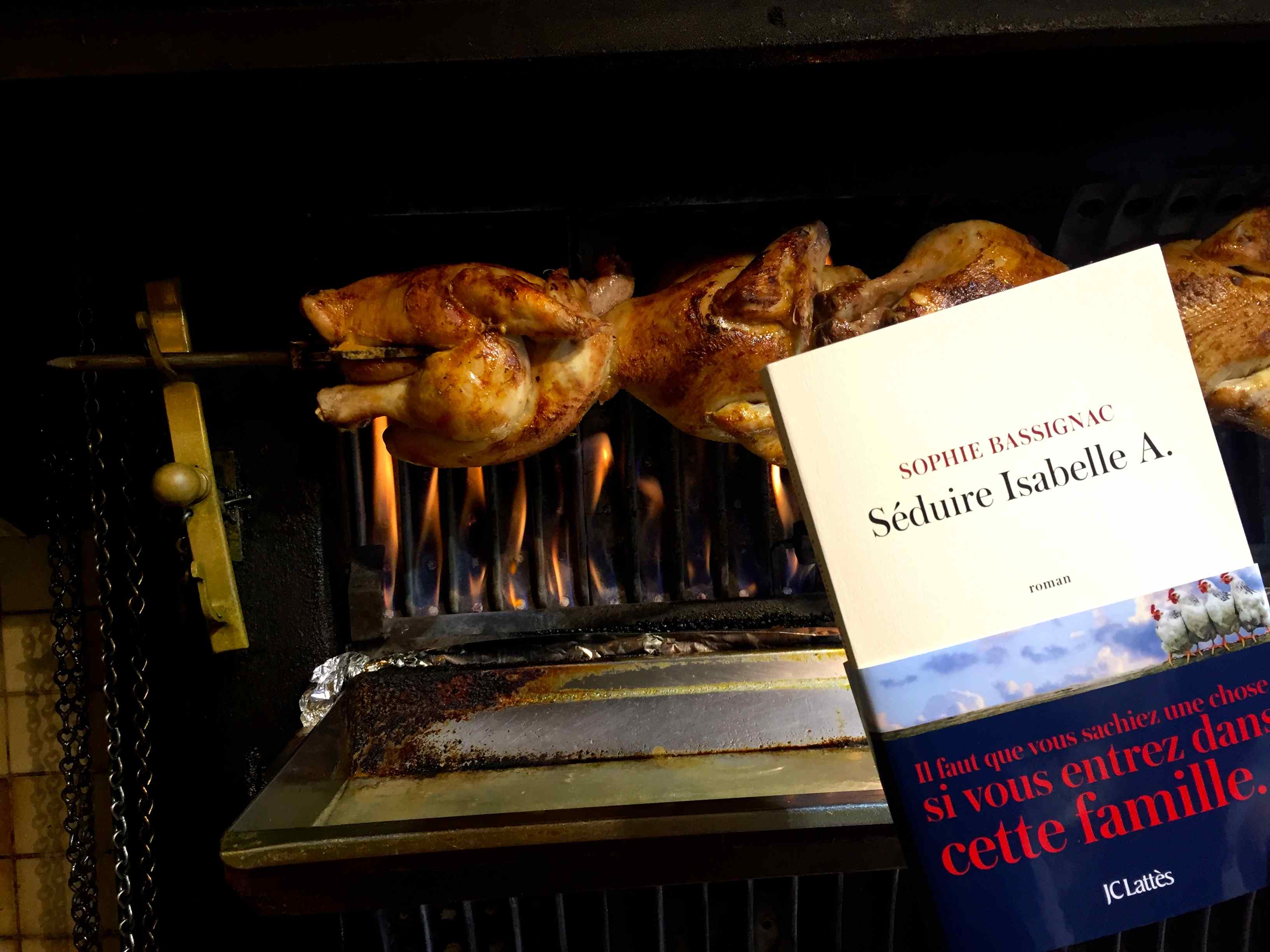C’est la première fois que j’ai ressenti, après la lecture d’un livre, le besoin de regarder ici et là quelques commentaires à son propos. Non pas que je cherchai une quelconque inspiration pour en rendre compte, mais parce que je fus singulièrement perplexe.
Je ne savais pas si mon indétermination était simplement de mon fait ou si, au contraire, elle était partagée.
Elle l’est, semble-t-il.
La Jeune épouse* est un texte envoûtant et ennuyeux. Et si j’en parle, moi qui n’écris jamais de mal sur un livre, si j’assume l’ennui de celui-ci, ses langueurs parfois agaçantes, ses multiples et brusques changements de point de vue narratif qui semblent parfois gratuits, c’est que son côté envoûtant l’emporte malgré tout.
Il s’agit à la fois d’une histoire d’initiation sexuelle, aimablement érotique, d’une jeune fille de dix-huit ans tout juste débarquée d’Argentine au début du siècle dernier pour épouser « Le Fils » (elle connaîtra un grand nombre de gens qui lui veulent du bien, et un bordel de rêve), doublée d’une brillante manipulation sur l’art d’écrire, de changer les règles, de se jouer de ses personnages et de l’objet « livre » lui-même qui s’écrit ailleurs.
C’est là le formidable talent de conteur d’Alessandro Baricco que j’aime depuis l’éblouissant Soie** ; sa capacité inouïe à nous emporter derrière les livres, là où, jusqu’ici, seuls les auteurs avaient accès.
La Jeune épouse est donc un magnifique livre avec ce qu’il y a parfois d’un peu chiant dans un magnifique livre.
*La Jeune épouse, Alessandro Baricco. Éditions Gallimard, coll. « Du monde entier ». Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro.
En librairie depuis le 1er avril et en Kindle sur lequel je l’ai lu, à Chilmark, Massachussets – où il n’y a pas de bordel.
**Soie, du même auteur, en Folio.