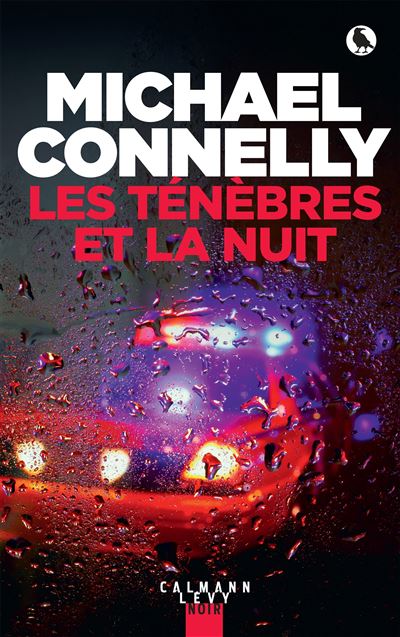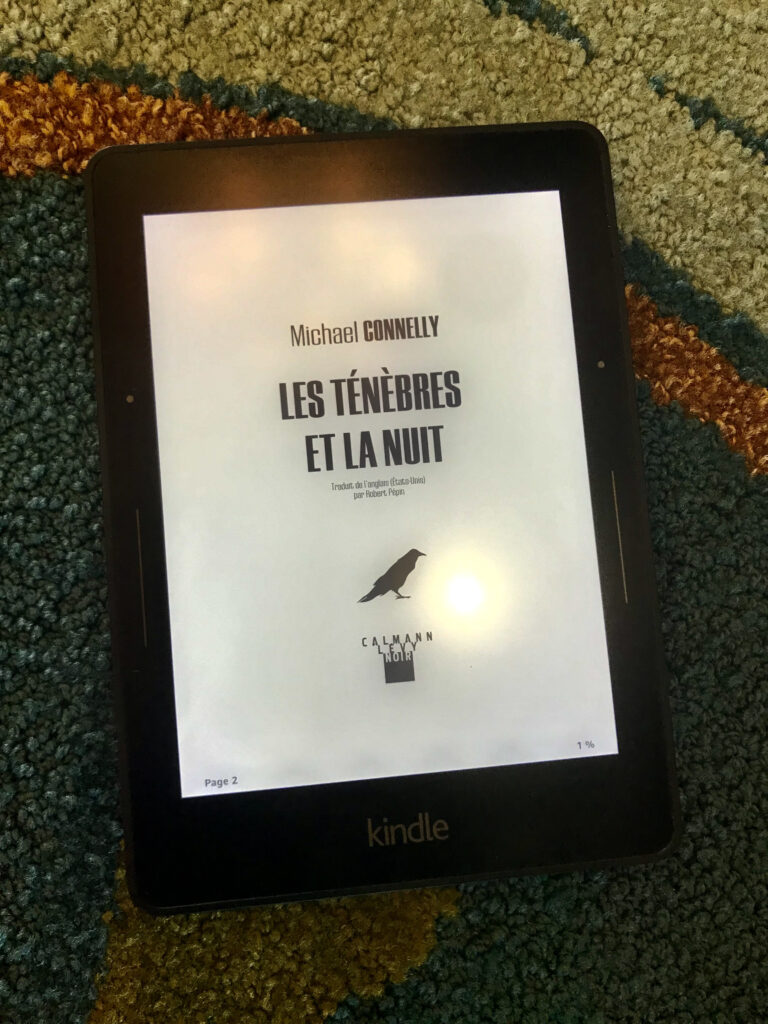Sans doute à cause de la température qui a brutalement chuté ces derniers jours, de l’envie de s’enfouir sous une couverture, de goûter un feu de cheminée, je me suis jeté sur le dernier polar de Michael Connelly, Les Ténèbres et la nuit*, exactement comme on se jette sur de la « comfort food ». J’ai découvert Connelly en 1993 avec l’époustouflant Égouts de Los Angeles. Et l’ai suivi les yeux fermés jusqu’au Poète (1997), qui marque une date dans le livre noir, comme Lawrence Block en avait tracé une autre avec Une danse aux abattoirs et, dans un registre plus impressionnant encore, Gregory Mcdonald avec l’inclassable The Brave (Rafael derniers jours, en français). Et puis je suis passé à autre chose.
Depuis 1997, Connelly a publié quarante romans — je passe les nouvelles et autres scénarii — et je suppose qu’on ne peut pas être extraordinaire à chaque fois. La preuve avec ce nouvel opus qui raconte une histoire cent fois racontée, celle de femmes sexuellement agressées et humiliées, enquête d’une flic et d’un ex-flic à la retraite, enquête qui patine à tel point que Connelly nous ressort le coup du promeneur de chien à minuit qui a tout vu et qui, du coup, débloque l’affaire, bref 450 pages bien longues, avec ce qu’il faut d’actualité pour la contemporanéité du propos : un peu de siège du Capitole, un peu de woke, un peu de cancel, et nous voilà repus. Au fond, j’ai eu ce que je voulais. Un « comfort polar » comme la « comfort food » que j’évoquais ci-dessus. On sait qu’on ne devrait pas, mais c’est quand même bon, et quand on l’a finie, on se dit qu’on n’aurait quand même pas dû, parce que c’était un peu lourd, mais on avait envie de ça aussi. Bref, la pataphysique de Boris Vian n’est pas bien loin.
*Les Ténèbres et la nuit, de Michael Connelly, traduit par Robert Pépin. Éditions Calmann-Lévy. En librairie depuis le 7 septembre 2022.