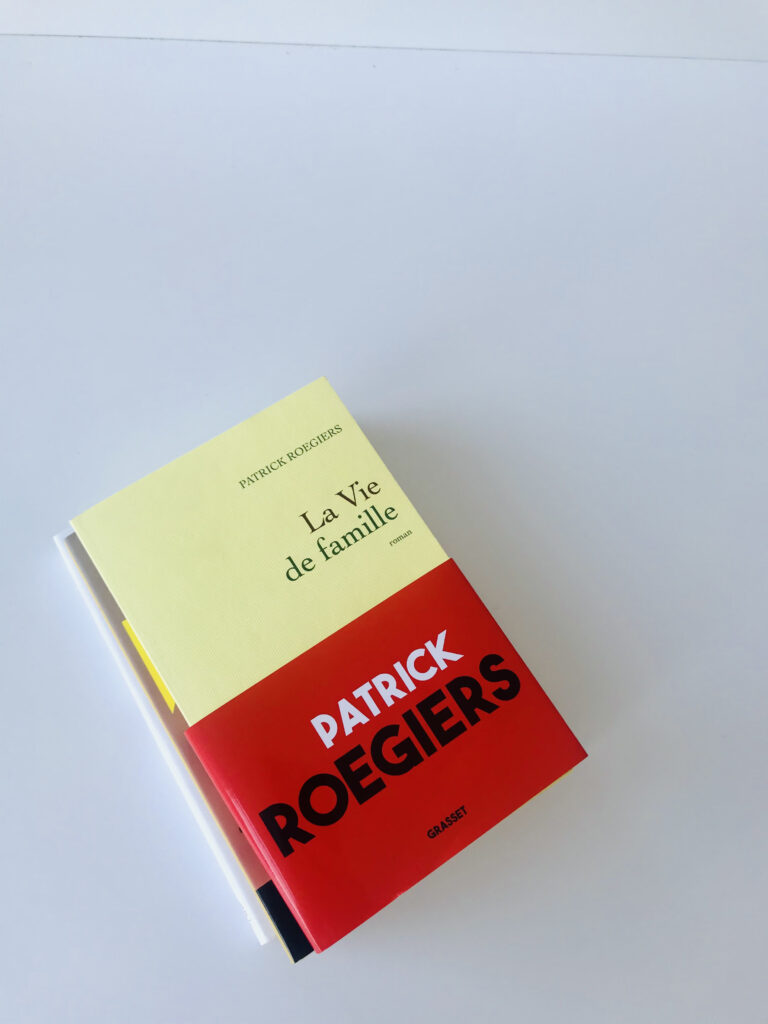
Un été rue des Saints-Pères (7/9). Au vu d’une ligne dans les remerciements : « À Jean-Paul Enthoven qui m’a incité avec amitié à oser me raconter enfin à la première personne » on suppose que le mot roman qui figure sur la couverture de La Vie de famille* est une argutie commerciale, tout comme le mot Nouveau dont on m’avait très tôt, dans la réclame, appris la valeur d’appel. Considérons donc ce livre comme un récit, et c’est justement parce que c’est un récit qu’il est tout à fait extraordinaire. Par l’écriture d’abord. Joyeuse, débordante, tumultueuse, jubilatoire, drolatique parfois, poignante à d’autres. Roegiers n’écrit pas, il chante, il vole et nous envole. Par les deux grands portraits ensuite qui composent son récit, celui de sa mère, celui de son père. Ah, sa mère. Il dézingue à tout va, griffe, fouette, emballe, claque, vitupère, langue de vipère, on est bien loin de la dégoulinade rose bonbon de la maman d’Albert Cohen dans son livre mausolée, on est ici dans la chair même d’un chagrin immense qui se traduit en colère laquelle est toujours un cri d’espérance. Et puis son père. Ah, son père. Cinquante ans d’amour avec sa femme et une fin de vie riquiqui, dans un studio d’étudiant, petit homme seul, ratatiné, qui perd la boule mais reste élégant jusqu’au bout des doigts. Je n’avais pas lu un portrait aussi poignant sur un père, sur l’étiolement, la disparition et j’ai refermé le bouquin en pensant que c’était pathétique la fin d’une vie et qu’on avait intérêt à sacrément en profiter puisqu’il ne reste rien. Rien que la douleur des enfants. Parfois un livre. D’un gamin de 70 ans.
*La vie de famille, de Patrick Roegiers. Chez Grasset, éditeur à Paris, sis rue des Saints-Pères. En librairie depuis le 15 janvier 2020.
Une joliesse, page 67, qui n’a rien à voir : « Les chansons durent trois minutes, on s’en rappelle toute la vie ».